1939-1946 à Chamoux
75 après, les plaies ne sont pas toutes refermées : nous ne l'oublierons pas dans ces pages.
Voici le témoignage (en cours de rédaction) d'Élisa (la fille de Léonie Francaz, dont ce site a recueilli de nombreux et précieux souvenirs), et les récits de Roberte et Élisa, qui ont toutes deux vécu le bombardement de Chambéry en août 1944.
On pourra aussi écouter le récit de Noël d'une "réquisition", qui faillit bien mal tourner, à la toute fin de la guerre.
Et enfin, on en parle peu: après la guerre, des Allemands ont dû à leur tour aider aux travaux dans les villages français: ils étaient Prisonniers de guerre; un souvenir de Renée en témoigne ici.
Élisa à Villardizier
Voici le témoignage d'Élisa : Chamoux a bien connu sa maman, Léonie Francaz, dont ce site a recueilli de nombreux et précieux souvenirs. Élisa a vécu à Chamoux pendant la guerre de 1939-45, mise à l'abri chez ses grands-parents; son regard sur ces années était donc celui d'une enfant à la découverte d'un village en temps de guerre.
1939-1945 : Temps de guerre à Villardizier
Récit d’Élisa Compain, 2015 - 1ère partie
À la veille de la guerre, Villardizier était un village qui s’était progressivement dépeuplé, comme en témoignent les recensements : 300 habitants en 1876, 179 en 1911, 105 en 1936.
En cause : l’émigration qui avait fourni des Forts aux Halles, des « bonnes », des fonctionnaires.
Et aussi, la « grande guerre » : dix jeunes n’en étaient pas revenus.
Des familles avaient disparu : 50 ménages recensés en 1911 ; 34 en 1936.
L’entre-deux-guerres avait par contre coïncidé avec un certain mieux-être : la plupart des cultivateurs avaient pu remplacer les attelages de vaches par un cheval ou un mulet. Certes, il fallait « coblier » avec un voisin pour les labours au brabant, qui exigeait un attelage de deux animaux. L’achat d’une faucheuse rendait moins pénibles la fenaison et la moisson.
Pour les ménagères, la lessiveuse en tôle galvanisée remplaçait avantageusement le cuvier. En 1938, l’eau de Frêterive arrivait dans les maisons, parfois équipées d’un simple robinet au-dessus d’une benne en bois. Si quelques-uns amenaient l’eau jusqu’à l’écurie, personne n’avait envisagé d’aménager une salle de bains – d’autant que les eaux usées allaient dans les « cunettes », le long de la rue.
On put constater un changement des mentalités : pour la plupart, les parents ne parlaient plus patois à leurs enfants.
Il n’existait plus de fournière pour cuire les pains le samedi, mais les boulangers de Chamoux faisaient la tournée en camionnette, échangeaient la farine contre du pain, kilo contre kilo. Les bouchers, les épiciers passaient aussi régulièrement dans le village, et même si les achats restaient modestes, les habitants étaient conscients d’avoir une vie plus facile qu’avant.
Septembre 1939
 La déclaration de guerre, annoncée dans le village par quelques habitants qui possédaient un poste de TSF1 (autre progrès), a suscité bien des inquiétudes.
La déclaration de guerre, annoncée dans le village par quelques habitants qui possédaient un poste de TSF1 (autre progrès), a suscité bien des inquiétudes.
Il y eut la mobilisation des hommes, la réquisition des chevaux… •>
Il y eut la mobilisation des hommes, jeunes et moins jeunes ; le plus âgé, 46 ans, avait déjà été mobilisé de novembre 1913 à avril 1919.
S’y ajouta la réquisition des chevaux et mulets. Il fallut donc remplacer les brancards des chariots par un timon, apprendre aux vaches à se comporter en animaux de trait. Tant bien que mal, les récoltes furent rentrées. Et dans l’hiver qui fut rude, les paysans apprirent avec colère que les chevaux réquisitionnés mouraient de froid. Vers la fin de l’hiver, les cultivateurs achetèrent – bien cher – des chevaux ou mulets dont il se disait qu’ils venaient de la Drôme: pourquoi ces jeunes animaux n’avaient-ils pas été réquisitionnés ? se demandait-on.
Pour les mobilisés, souvent installés dans des conditions précaires, et confinés dans l’inaction de la «drôle de guerre», l’hiver avait été rude.
Tout changea au printemps :
- 10 avril, invasion de la Norvège par l’Allemagne, suivie de l’envoi de troupes françaises – dont des chasseurs alpins.
- 10 mai, l’attaque allemande aboutit à la percée du Front dans les Ardennes; néanmoins, l’espoir subsistait : on se souvenait de la «grande guerre», de Verdun, et de la victoire. Mais l’invasion s’accélérait : il fallait se remémorer les souvenirs d’école pour situer mentalement les villes citées par la TSF, car le journal ne donnait plus que des précisions dépassées.
- 10 juin : entrée en guerre de l’Italie. Cette fois, le danger nous concernait. Peut-être à tort, les Savoyards étaient persuadés que Mussolini voulait annexer la Savoie. Et on savait que des troupes françaises mobilisées en septembre sur la frontière des Alpes avaient été envoyées vers le nord ou l’Est : peu nombreux, les soldats qui restaient pourraient-ils résister aux Italiens ? et l’aviation bombarderait-elle les villes et les usines ?
Comme nous habitions en Tarentaise, près d’un centre industriel, les parents nous conduisirent, mon frère et moi, à Villardizier, chez nos grands-parents. Ils en repartirent rapidement, car les militaires qui minaient le pont d’Albertville ne leur avaient pas garanti que le passage serait encore possible le soir.
Je fus donc amenée à participer à la vie du village : aider aux travaux des champs, mais aussi, entendre les conversations dans la rue, à la forge ou à la fruitière (lieux « de sociabilité »).
L’inquiétude dominait même si certains envisageaient d’accueillir l’envahisseur à coups de fourches : on rappelait l’exploit de cette villageoise qui avait assommé un soldat autrichien avec une «bellye2» (sans doute en 1814 ou 1815). Personne n’eut à faire preuve d’héroïsme, car l’armistice arrêta l’invasion allemande entre Aix et Chambéry, tandis que les troupes italiennes occupaient trois communes de Tarentaise, et quelques autres en Maurienne (on les accusait même d’avoir avancé après l’armistice). Celle-ci fut donc accueillie avec un certain soulagement.
Je ne pense pas avoir entendu parler de l’appel du 18 juin à l’époque.
L’armistice.
Progressivement, les mobilisés rentrèrent, sauf trois prisonniers : Jules Maître, Marcel Ferroud, et François Vuillermet lequel, ayant eu la chance de rester en France, eut le courage de tenter l’évasion, avec les risques que comportait le franchissement de la « ligne de démarcation».
Le village s’était semble-t-il accommodé de cette paix relative : restait la crainte de devenir «piémontais», et le sentiment anti-italien resté latent en fut amplifié.
Les quelques immigrés italiens, jusque là bien acceptés, ont-ils eu conscience de cette évolution3?
Comment fut accueilli le changement de régime ? Sans doute, pour la plupart, résignation de ce qu’on ne peut empêcher, espoir que le nouveau chef d’État ne cèderait pas la Savoie à Mussolini. Il n’y eut pas à Villardizier, comme de fut le cas ailleurs, de tentative de revanche des «blancs» à l’égard des «rouges». À partir de 1941, le calendrier des postes, avec photo du «Maréchal», fut affiché dans les cuisines, sans état d’âme, mais sans respect excessif.
Des réticences s’amplifièrent face à certains aspects de la politique: l’entrevue Pétain-Hitler à Montoire, et plus localement, les poursuites contre Pierre Cot4, apprécié pour avoir joué un rôle important pour l’adduction d’eau.
La situation matérielle s’aggravait,
et les cultivateurs furent frappés de lourdes réquisitions. Certes, ceux qui récoltaient ne souffrirent pas de la faim et gardaient même des denrées disponibles pour les proches partis en ville, au moins au sud de la «ligne de démarcation». On vit aussi revenir à Villardizier des cousins éloignés, qui s’étaient opportunément souvenus de leurs racines savoyardes. On vit surtout des Mauriennais (ou supposés tels) venus en train jusqu’à Chamousset, et cherchant à acheter haricots secs, maïs, pommes de terre, huile, œufs, vin; car les treilles qui séparaient les champs rapportaient bien. Ce n’était plus comme en 1935, où il avait fallu brader le vin à quelques sous le litre, pour loger la nouvelle récolte. Les raves elles-mêmes trouvaient preneur.
Ce ne fut pourtant pas un très grand marché noir: beaucoup d’exploitations ne dépassaient pas deux ou trois hectares, certes minutieusement cultivés, et de bonne terre (sauf peut-être pour le blé).
Le blé. Des étés secs réduisirent les rendements. Les contrôles du ravitaillement furent plus pesants : au contrôleur local, plus ou moins zélé suivant sa conception du métier, s’ajoutait le surveillant des batteuses, qui comptait les quelques sacs de grains.
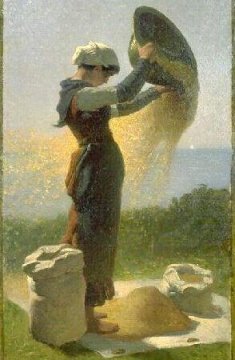 Il fallut reprendre quelques anciennes habitudes: on entendit dans les granges les battements des fléaux.
Il fallut reprendre quelques anciennes habitudes: on entendit dans les granges les battements des fléaux.
Venait ensuite l’élimination de la «balle» avec le van à bras. Deux travaux pénibles.
<• le van à bras (une image de la vie aux champs au… XIXe siècle)
Ensuite, il s’agissait de porter discrètement vingt à trente kilos de blé au moulin sur un vélo, parfois sur une luge lors des hivers froids. Les boulangers avaient renoncé à leurs tournées, et ne vendaient dans leurs boutiques que du pain noir, assez indigeste.
À Chambéry, on pouvait acheter des tamis : les fabricants et commerçants s’adaptaient aux nouveaux besoins des clients. Que de temps passé à ces travaux supplémentaires : «sasser» la farine, préparer les levains, pétrir (les préposés familiaux à ce travail n’avaient pas perdu la main).
Il y eut plus de tâtonnements pour ajuster le chauffage du four. Remercions encore les frères Simillon, qui prêtaient gratuitement leur four, et aussi leur grilloir à café pour torréfier… l’orge.
Le café naguère réservé aux jours de fête était dans beaucoup de maisons d’usage quotidien pour le déjeuner matinal ; mais le mélange indéfinissable obtenu avec les tickets était insuffisant en quantité. On s’ingénia à trouver des succédanés (mot inconnu jusque là), même si des rumeurs affirmaient que l’orge ou le blé grillés rendaient cardiaque ou aveugle.
En plus, griller un ou deux kilos de céréales était considéré par l’Administration comme un inadmissible gaspillage – donc, interdit.
Autre pratique interdite : prélever un peu de lait chaque jour pour en faire du fromage après avoir levé la crème. Pour obtenir du beurre, les uns battaient la crème à la fourchette, d’autres s’étaient procuré une baratte en verre (là encore, fabricants et commerçants s’étaient adaptés aux besoins nouveaux)
Mais que de temps passé à tourner la manivelle de la baratte !
L’essentiel de la production de lait devait être porté à la fruitière. La ration de beurre allouée aux cultivateurs était nettement supérieure à celle des autres consommateurs, et la fruitière de Villardizier l’a toujours fournie – et même au-delà. À l’époque, des commerçants qui affirmaient ne pas pouvoir fournir les rations officielles étaient accusés de les vendre au marché noir.
 Mais la fruitière de Villardizier devait bien sûr se conformer aux règlements ; par exemple, écrémer le lait au maximum, ce qui valut aux tommes ainsi fabriquées d’être qualifiées de « moleskine » par une cliente au parler pittoresque.
Mais la fruitière de Villardizier devait bien sûr se conformer aux règlements ; par exemple, écrémer le lait au maximum, ce qui valut aux tommes ainsi fabriquées d’être qualifiées de « moleskine » par une cliente au parler pittoresque.
<• la fruitière
Autre service rendu à la fruitière, à certaines époques ; fournir du petit lait. En premier, X, qui vivait de peu, tendait sa gamelle, et le fruitier essayait de récupérer les brins de caillé qui surnageaient. Je revois le vieil homme, tenant le récipient dans ses mains tremblantes, s’empresser de boire le petit lait, tandis que tour à tour étaient remplis les seaux destinés aux cochons.
Dans la plupart des maisons, on achetait un porcelet au printemps : ceux qui avaient renoncé à cette pratique dans les années trente y étaient revenus. Mal logé dans un «boédet5» sombre et exigu, le «caïon6» était en revanche bien soigné avec une alimentation très étudiée : plus de « vert » au début pour «faire grandir les boyaux», plus de farineux ensuite pour l’engraisser. Que d’inquiétudes quand notre animal fut atteint de rachitisme! les voisins prodiguaient des conseils: le sortir faire la sieste, les pattes au soleil et la tête à l’ombre.
Je fus préposée pour veiller à déplacer l’animal suivant l’ensoleillement, tout en lisant un des quelques livres de la maison.
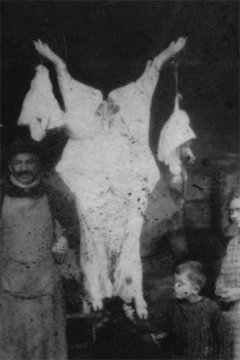 Comme il n’y avait pas de pharmacie à Chamoux, je suis allée à la Rochette à bicyclette acheter des médicaments. Le cochon put marcher un peu plus facilement, et cahin-caha atteindre… son inévitable destin.
Comme il n’y avait pas de pharmacie à Chamoux, je suis allée à la Rochette à bicyclette acheter des médicaments. Le cochon put marcher un peu plus facilement, et cahin-caha atteindre… son inévitable destin.
Par crainte des réquisitions, le sacrifice du cochon était sensé se dérouler discrètement – chose difficile avec les cris de l’animal!
Apparemment, contrôleurs et gendarmes étaient ailleurs, et chaque année, on put impunément ébouillanter l’animal dans «l’écouélor7», le dépecer, préparer la fricassée – plat de résistance du «repas du cochon» -, cuire les boudins. La fabrication des diots, les salaisons, occupaient la maisonnée plusieurs jours durant.
La mort du caïon
L'Occupation
Depuis l'armistice de juin 1940, la Savoie faisait partie de la zone libre, à l'exception de quelques communes de Haute Maurienne et Haute Tarentaise, occupées par les Italiens.
À Chambéry siégeait une commission d'armistice italienne.
Le débarquement, et la fin de la zone "libre"
Le 8 novembre 1942, des troupes anglo-américaines débarquèrent en Algérie et au Maroc.
Le 11 novembre (date symbolique) les troupes allemandes franchirent la ligne de démarcation au mépris des conventions d'armistice.
Le 13, elles étaient à Chambéry, puis cédèrent la place aux Italiens. Vit-on des soldats italiens à Chamoux?
À Chambéry, cette armée ne fut pas toujours prise au sérieux: des jeunes se vantaient d'avoir coupé les plumes qui ornaient le chapeau des Alpini. Lors des sorties hebdomadaires de "plein-air", les professeurs de gymnastique nous faisaient souvent chanter "della villa de çambery tous nos troupiers i sont partis"… hors de la présence desdits troupiers. Il y eut tout de même des incidents dont les journaux ne faisaient évidemment pas état, et vraisemblablement, des arrestations.
Mais près le débarquement allié en Sicile et la destitution de Mussolini (27-7-1943), les troupes allemandes envahirent les régions françaises jusque-là occupées par les Italiens.
Des Allemands à Chamoux
Ainsi, des soldats allemands arrivèrent à Chamoux, et occupèrent entre autres lieux la forge de Louis Maître pour réparer les fers de leurs chevaux (ce qui nous étonna, car nous les imaginions équipés de véhicules motorisés). Nous n'aurions jamais parlé à un Allemand, sans l'intervention jugée intempestive d'un "je-me-mêle-de-tout". Mais le garde d'écurie avait envie de parler - dans la mesure du possible à cause de la barrière de la langue. Les larmes aux yeux, il nous montra la photo de sa femme et de sa petite fille, qu'il n'avait pas revues depuis de longs mois; il évoqua avec une expressive grimace la Russie d'où il avait été rapatrié pour une blessure à la main apparemment pas trop grave. Nous savions que les Allemands étaient endoctrinés dès leur jeunesse pour en faire des nazis fanatisés prêts à tous les sacrifices pour le 3ème Reich "qui devait durer 1000 ans". Mais Goebbels et ses adeptes n'avaient pas réussi à déshumaniser tous leurs compatriotes - heureusement…
Les Allemands ont quitté Chamoux où apparemment ils n'ont pas laissé - cette année-là - un trop mauvais souvenir: "Je ne les aime pas, disait une sexagénaire, mais ils sont disciplinés, et ont fait des efforts pour ne pas trop nous gêner". Le bruit a couru que leur troupe avait été bombardée sur le chemin de l'Italie. Ce n'était qu'un bruit, invérifiable; mais j'ai alors pensé à une petite Allemande blonde, qui, peut-être, ne reverrait jamais son papa…
L'école en temps de guerre : des années scolaires perturbées
Récit d’Élisa Compain, 2015 - 2ème partie
Élisa nous raconte aussi ce que fut le temps de la guerre pour les écoliers de la région : ses souvenirs dépassent donc le cadre de Chamoux.
Depuis des temps immémoriaux… pour les écoliers - et même dans les souvenirs d'instituteurs, l'année scolaire commençait le 1er octobre, et depuis quelques années seulement, se terminait au 14 juillet.
À la rentrée d'octobre 1939, beaucoup d'instituteurs étaient mobilisés : leurs classes furent donc provisoirement supprimées, ce qui amené une augmentation des effectifs, avec parfois mixité! (surtout à partir de 4 ou 5 classes, garçons et filles étaient séparés depuis le Cours élémentaire).
Dans beaucoup d'écoles, on s'activait pour les mobilisés de la commune, pour un "filleul de guerre" sans famille, proposé par les services sociaux : écrire des lettres, tricoter des écharpes ou des chaussettes, faisaient partie des "activités dirigées" du samedi après-midi (autre innovation des années 1936 à 1938)
Il y eut aussi, dès le début de la guerre, l'arrivée de "réfugiés" - beaucoup moins en Savoie que dans l'Ouest de la France, où il s'agissait de déplacements massifs et organisés d'enfants ou d'inactifs de Paris ou des régions industrielles proches de la frontière allemande.
Les enseignants veillèrent à bien accueillir ces nouveaux écoliers, et en particulier à intégrer rapidement les enfants de réfugiés espagnols qui avaient eu la chance de se faire embaucher.
Au pire moment de la débâche, les classes fermèrent plus ou moins longtemps, et reprirent dès que possible, jusqu'à fin juillet, pour reprendre au 1er septembre à l'école primaire: il fallait remettre la France au travail.
Un certain nombre d'instituteurs avaient été faits prisonniers, notamment des chasseurs alpins en Norvège. Par contre, certains habitants des régions frontalières ne purent pas rentrer chez eux, et obtinrent un poste en Savoie.
Quoique moins atypiques, les années 1941 à 1943 connurent quelques changements.
Tout d'abord, le patriotisme officiel avec le salut au drapeau le lundi matin, et un véritable culte du chef de l'État: son portrait dans toutes les classes, son hymne (Maréchal, nous voilà), des dessins ou des lettres à lui envoyer, parfois un discours à écouter - ou imposé en dictée.
La pénurie de chauffage lors d'hivers particulièrement rigoureux amena à ne chauffer que certaines classes : les grands y travaillaient le matin de 8 à 12 heures, six jours par semaine, soit 24 heures hebdomadaires au lieu de 30 précédemment; les autres de 13 à 17 heures.
Lorsque les bombardements alliés se multiplièrent, toute école située à moins de 500m d'une voie ferrée dut revenir à ce système pour n'accueillir que la moitié des élèves en même temps…
Et, à Chambéry, le bombardement américain du 26 mai 1944 mit fin à l'année scolaire.
Entre timides espoirs et tragédie
Récit d’Élisa Compain, 2015 - 3ème partie
Élisa nous raconte maintenant le temps des débarquements, et des bombardements.
Avec le débarquement allié en Afrique du Nord (8 septembre 1942) étaient apparues quelques lueurs d'espoir. Espoirs amplifiés au début de février 1943 par la nouvelle de la capitulation à Stalingrad d'une armée allemande de 300.000 hommes. L'avancée des troupes soviétiques vers l'Ouest, un temps compromise par une contre-offensive allemande, remporté de nouveau succès dans l'été.
Nous suivions tout cela sur la carte de Russie affichée au mur de la cuisine.
En mai 1943, les armées allemandes et italiennes étaient chassées d'Afrique du Nord. Les Alliés débarquèrent en Corse, en Sicile, en Calabre.
J'appris en allant porter le lait à la fruitière, la nouvelle de l'armistice entre l'Italie et les Alliés, le 8 septembre: nouvelle accueillie avec un enthousiasme bruyant par les optimistes; mais un rabat-joie fit remarquer que le plus dur restait à faire - et il n'avait pas eu tort: déjà, les Allemands avaient envahi la zone occupée jusque là par les Italiens…
Si un peu d'espoir revenait, les difficultés matérielles s'aggravaient: diminution des rations alimentaires, de la qualité et de la quantité des attributions de charbon, savon, etc, usure des vêtements, des chaussures. Que d'heures passées à repriser les chaussettes, à détricoter des maillots déchirés, à défriser la laine et à en renouer les brins pour la réutiliser… Que d'ingéniosité de la part des mamans pour créer des "jacquarts" devenus à la mode depuis le film "L'éternel Retour" avec Jean Marais. Et ces vêtements qu'il fallait rallonger, élargir pour les jeunes qui grandissaient malgré la sous-alimentation...
Mais tout cela était peu de choses à côté de ce que nous apprenions par ailleurs; mauvaises nouvelles qui concernaient de plus en plus notre environnement proche.
Nous connaissions des requis et des réfractaires au S.T.O. (Service du Travail Obligatoire en Allemagne, qui concernait des classes d'âge entières).
Nous avions appris l'arrestation de Résistants parmi nos amis ou connaissances, arrestations suivies de tortures, puis de déportation pour certains - mais sans imaginer l'organisation systématique de l'atrocité des camps de concentration.
Et les incendies, les exécutions…
En janvier, au Biollay, dans la banlieue proche de Chambéry, un fermier soupçonné d'aider la Résistance a été fusillé, son corps jeté dans la maison qui fut incendiée. Les pompiers de Jacob-Bellecombette accueillis à coups de mitraillettes ne purent intervenir.
Près de deux mille personnes ont assisté aux obsèques de la victime, Ernest Grangeat, dans l'église de Maché, et un interminable cortège accompagna sa dépouille jusqu'au cimetière de Charrière Neuve8, témoignant ainsi de l'émotion de la population - y compris de ceux qui, comme nous, n'y ont pas assisté.
Émotion aussi au Lycée de Jeunes Filles de Chambéry, tant parmi les élèves que parmi le personnel: deux élèves - deux sœurs - avaient été arrêtée devant le Lycée, parce qu'elle étaient juives. Cela s'était passé un samedi de mars, entre treize et quatorze heures, au milieu d'un groupe d'élèves qui discutaient tranquillement. La Directrice fit sortir discrètement du Lycée d'autres élèves juives, dont les noms furent effacés des listes au "Corrector".
(Nous n'avons appris que bien plus tard cette action de la Directrice. Une des deux sours arrêtée devant le Lycée n'est pas revenue de déportation, de même qu'une autre élève.)
Mais il y eut aussi des arrestations à domicile.
Beaucoup de Juifs avaient fui les régions occupées par les Allemands pour se réfugier dans la zone d'occupation italienne, notamment en Savoie: il était en effet notoire qu'une certaine tolérance était manifestée par l'occupant italien vis-à-vis des Juifs8. Mais depuis l'arrivée des Allemands, une véritable chasse aux Juifs était engagée.
De tout cela, le Journal (réduit à une seule feuille), et la Radio officielle ne disaient rien. Il en était de même pour les Actualités cinématographiques qui, par contre, montraient les déraillements de trains de voyageurs provoqués par les attentats des "Terroristes", détaillaient les vues de ruines résultant des bombardements, insistaient sur le nombre de victimes civiles.
Le 26 mai 1944, le bombardement de Chambéry a fait près de 200 morts (dont une de mes camarades de classe), et démoli une partie de la ville. La fumée des incendies se voyait depuis Chamoux. (Les ultimes foyers des incendies ne furent définitivement éteints que le 25 juin)
En revanche, la gare de Chambéry qui était visée laussait passer les trains moins de 3 jours après…
Des voisins de Villard-Dizier réquisitionnés pour déblayer les voies nous ont affirmé "ne s'être pas fatigués".
On craignait un nouveau bombardement. Aussi, nos parents décidèrent-ils de nous envoyer à Villard-Dizier, mon fère et moi, dès que possible (en effet, l'immeuble où se trouvait le siège des cars Franchiolo avait été victime du bombardement).
Le jour prévu était le 6 juin. Notre père, toujours très matinal, avait appris par la T.S.F. (radio) la nouvelle du débarquement en Normandie, ce débarquement tant espéré, tant attendu! Raison de plus pour nous éloigner de la gare, car les bombardements pouvaient s'intensifier. Nos parents devaient rester à leur poste, mais ils étaient persuadés que nous serions à l'abri du danger à Villard-Dizier.
Munis d'un minimum de bagages, il nous fallut d'abord parcourir à vélo les trois kilomètres qui nous séparaient du Café de la Terrasse (près du Palais de Justice), d'où partaient désormais les cars Franchiolo. Mon frère juché sur une selle installée sur le cadre du vélà paternel, moi suivant sur mon vélo personnel, ce fut un trajet sans encombres dans les rues vides d'automobiles.
Un dernier "au revoir", et en voiture, dans un car qui n'était pas bondé comme à l'ordinaire: était-ce à cause de la nouvelle du débarquement - certains ayant pu craindre des contrôles ou des barrages de routes.
Après un voyage dans incident, nous voilà à Chamoux. Je récupère mon précieux vélo qui a voyagé sur le toit du car. En route pour Villard-Dizier, "réfugiés" chez nos grands-parents… comme déjà en juin 1940.
Des journées qu'on n'oublie pas
Récit d’Élisa Compain, 2015 - 4ème partie
Élisa nous raconte ici les journées d'août 1944.
1er août 1944 - Chamoux encerclé.
Comment avons-nous appris de jour-là l'inquiétante nouvelle : "les Allemands encerclent Chamoux"?
Alarmés, nous essayions d'en savoir plus : à travers les persiennes, nous avons aperçu un homme en tenue de travail, encadré par des soldats allemands, dans la propriété voisine. Nous avons plaint ce malheureux. Heureusement pour lui, il put justifier... qu'il n'était qu'un cueilleur de champignons.
C'était beaucoup plus grave à Chamoux: les hommes rassemblés dans la cour de l'école, le maire Michel Jandet et le secrétaire de mairie Lucien Maître obligés de guider les Allemands au domicile des Résistants recherchés.
Maire et secrétaire conduisirent tout d'abord les militaires sur la route de Montendry, où ils étaient sûrs que les jeunes recherchés ne seraient pas chez eux. Ils espéraient que leur passage aurait alarmé tous ceux qui risquaient l'arrestation. Furieux de n'avoir trouvé personne au gîte, les Allemands assénèrent quelques coups à leurs guides, obligèrent le maire à porter les portes du hangar des pompes à incendies et à en décoller les affiches mises par les Résistants.
Mais le plus tragique se passait ailleurs: Félicien Aguettaz, qui avait pris la précaution de passer la nuit hors de Chamoux, fut arrêté par les militaires qui cernaient le chef-lieu, et amené aux écoles. Il fut abominablement torturé, pour lui faire avouer sa participation à la Résistance, avec des accusations précises. N'obtenant pas ce qu'ils désiraient, les Allemands l'emmenèrent avec eux à Montendry, à la recherche des maquisards.
Le corps martyrisé de Félicien Aguettaz fut retrouvé dans une grange sur la route du Fort de Montgilbert.
Les Allemands ont aussi arrêté un Juif réfugié à Chamoux, Émile Moscovitz. Son corps fut retrouvé le 9 août près de la RN6, non loin du Pont Royal.
16 août 1944. Bombardement américain sur Pont-Royal.
Nous nous apprêtions à aller travailler dans les champs, ce matin-là comme les autres jours de semaine. Le cheval harnaché attendait patiemment d'être attelé au chariot.
Soudain, un grand bruit: des avions - peut-être 4 - débouchèrent de la cime du Mont Fauge, descendirent en direction de la vallée de l'Isère.
Et ce fut l'explosion. Les portes du hangar vibraient, le cheval affolé ruait, tandis que nous regardions les avions remonter (à la verticale nous semblait-il)
Allaient-ils s'écraser contre l'Arclusaz? Non, un brusque virage les ramena au-dessus de la vallée de l'Isère en direction d'Albertville.
Résultat du bombardement : le pont visé était en partie détruit, et tout passage de trains en direction de l'Italie, impossible.
En Italie, "l'escargot allié" dont les affiches allemandes raillaient la lenteur, arrivait à Florence; mais de durs combats continuaient; l'arrivée de renforts allemands en hommes et matériel, seraient désormais plus difficile.
Mais, nous rappelant le bombardement de Chambéry, nous nous posions des questions:
- pourquoi n'avoir pas bombardé uniquement le pont de chemin de fer?
- Pourquoi, surtout, les bombardiers américains avaient-ils lâché leurs bombes de si haut?
Le bombardement du pont avait fait, disait-on, une victime : une de trop bien sûr, qui avait eu la malchance de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment.
Mais en cette année 1944, le danger était partout.
Un site à visiter pour en savoir plus sur ce bombardement : http://www.railsavoie.fr/liberation03.html
Lire 2 Lycéennes sous les bombes
5/8-2015 - Transcription A. Dh.
Notes
1- Poste de TSF : poste de radio
2- Bellye : …
3- Lire à ce sujet le témoignage d’un Italien de Montmeilliant, Louis Baima : Né dans les copeaux (Fontaine de Siloe, 2013-03-01) : il a clairement ressenti ce changement de regard à l'époque)
4- Pierre Cot : Pierre Jules Cot, né en 1895 à Grenoble (Isère) et mort le 21 août 1977 à Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier (Savoie), fut un homme politique très actif, de plus en plus engagé à gauche, résistant pendant la guerre. Pour la Combe, il fut aussi un député de la Savoie, et le maire de St-Jean Pied-Gauthier de 1929 à 1971.
5- Boédet : soue à cochon
6- Caïon : cochon
7- écoulélor : auge dans laquelle on mettait le corps de l'animal pour l'ébouillanter
8- d'après J.O. Vioud: Chambéry 1944
2 Lycéennes
Deux lycéennes sous les bombes
En octobre 2008, l'Association des Anciennes élèves du Lycée Louise de Savoie de Chambéry a publié un document précieux: Le Lycée sous les bombes - des lycéennes racontent l'Occupation1.
Anne-Marie Vallin avait en effet réuni et organisé les témoignages d'une vingtaine de camarades, qui furent tout comme elle lycéennes à Louise de Savoie.
Elles vécurent le bombardement du 26 mai 1944.
Parmi elles, Robert Burnier et Élisa Compain ont de fortes attaches avec Chamoux. Elles nous ont transmis leurs témoignages que l'on peut retrouver dans l'ouvrage cité ci-dessus.
Roberte Maître (épouse Burnier), seize ans et demi, en classe de seconde
Ce jour là, le 26 mai 1944
Ce jour là devait être un mardi. Nous avions, les secondes M2, cours de dessin au 2ème étage cote Lycée garçons suivi de 2 heures d'histoire de la littérature avec «mademoiselle Houter français». C'était une journée d'exposés complétés par un plus du professeur. Ce jour là j'avais un exposé avec deux camarades, mon plan était prêt mais je n'avais pas écrit mon texte. Mademoiselle Gerbelot-Barillon professeur de dessin nous a permis de travailler pendant son cours. L'alerte a sonné, nous savions ce que nous devions faire, nous avions déjà vécu plusieurs alertes.
je me souviens qu'il y avait une certaine agitation peu coutumière, pas de la peur, simplement une excitation : pour moi mon texte n'avait guère avancé. Nous nous précipitâmes dans l'escalier, arrêtées au premier par mademoiselle Déclert la Surveillante Générale d'externat qui nous ramena à plus de calme. Nous longeâmes, sous le préau, les classes de la base du U pour nous diriger vers les abris qui se trouvaient, en tout cas pour le nôtre, sous l'aile de l'internat. Nous empruntâmes l'escalier côté cuisine. « La cuisine » était installée dans un petit bâtiment dans le prolongement de la base du U en direction de l'avenue Pierre Lanfrey.
Les caves avaient été très bien aménagées, des murs avaient été construits en chicane, le plafond renforcé par des rondins de bois reliés deux à deux par des U métalliques entrecroisés, des lucarnes très petites, situées en ras de plafond, au ras du sol à l'extérieur, n'avaient pas été obstruées ce qui fait que nous n'avions pas le sentiment d'être enfermées. Tout était éclairé électriquement bien sûr. Sous ces fenêtres on avait placé des escaliers du genre échelles.
Tout est devenu noir, je ne pouvais plus respirer...
Nous sommes restées dans les caves longtemps. Par deux fois, je grimpais à l'échelle, passais mon corps à travers la fenêtre, sortais ma tête pour voir les avions que nous entendions passer. Au troisième passage je grimpais à nouveau, cette fois les avions passaient au-dessus du bâtiment en le longeant alors que les précédents arrivaient perpendiculairement au bâtiment.
Je revois encore les trois triangles formés par les avions que je comptais : 18, je ne pouvais voir entièrement la formation. Je rentrais ma tête et me tournais vers mes camarades pour leur dire: «J'en ai compté 18». A ce moment là tout est devenu noir, je ne pouvais plus respirer, je mangeais de la poussière, je n'entendais plus rien, mes camarades se taisaient, puis tout à coup une d'entre elle s'est mise à prier, nous avons continué, j'étais toujours sur l'échelle la tête au plafond. Je ne sais pas combien de temps je suis restée seule. Soudain en face de moi une brève lueur, une expression traversa mon esprit «Les hallucinations d'Edgar». Pourquoi en un tel moment ? Je n'ai jamais su.
Soudain j'ai eu besoin du groupe. Comment ai-je traversé la cave ? Je ne me souviens pas! En tout cas j'étais à l'autre bout.
En tâtonnant j'ai trouvé l'emplacement d'une porte. J'ai continué à avancer. Dans la cave à côté de la nôtre il y avait bien un mètre de poussière, j'enfonçais. Nous nous étions toutes mises à tousser, une camarade m'a rejoint, la clarté s'est faite plus forte, nous avons constaté qu'un plancher s'était effondré ; j'ai trouvé dans le mur un emplacement dégagé par un bloc effondré, je m'y suis installée, j'avais le plancher de la «petite étude» au niveau de mon nez. Je levais les yeux, j'avais en face de moi, plus loin l'escalier, qui desservait les dortoirs, intact. Tout le reste était cassé, inexistant, disparu. Tout en haut, un lit laissait flotter ses draps au vent léger.
Je suis revenue près de ce que j'avais pris pour une porte ; des tuyaux emmaillotés de plâtre pendaient au mur, avec ma camarade nous avons pensé au gaz, nous nous sommes bien gardées de nous y accrocher.
Un petit oiseau chantait sa joie de vivre...
Au fur et à mesure que la poussière retombait nous y voyions mieux. Sur ma gauche, à travers le plancher effondré le ciel était bleu. Sur une branche d'arbre effeuillée, un petit oiseau chantait sa joie de vivre; massées nous l'écoutions. Puis apparurent, dans ce qui avait été la porte de la petite étude, deux Allemands de l'École Normale. je n'ai pas eu la présence d'esprit de crier, mais ma voisine a lancé un «au secours!» vibrant et toute la cave a crié aussi. Nous avons été entendues. Une de nous a dit «Il faut faire l'appel». Ce qui a été fait, nous connaissions la liste par cœur. Toutes, à notre tour nous avons répondu «présent».
Quel bonheur! Des petites 6ème sont venues vers nous. Là où nous avions vu les Allemands, un monsieur de la défense passive est apparu avec une bouteille d'eau «je ne sais plus si nous l'avons récupérée». Une petite 6ème a reconnu la voix de son père elle a crié «Papa, papa!» Il nous a dit «Ne bougez pas on va vous dégager, y a-t-il des blessés? Non!» Une camarade qui venait de Modane avait subi son 3ème bombardement, elle était choquée plus que nous. Je crois que c'est à ce moment que j'ai vraiment réalisé ce qu'était la guerre !
Finalement nous avons été dégagées côté cuisine, nous sommes arrivées à l'escalier au moment où des hommes de la défense passive, évacuaient sur un brancard une personne dont nous n'avons vu qu'un pied barbouillé de sang.
Sorties des caves nous suffoquions, nous avions du mal à retrouver une respiration normale. Pas de répit cependant, on nous informa qu'il y avait une bombe non éclatée dans la rue Marcoz, nous partîmes en courant, on nous dirigea vers une maison de la Société d'Électricité où on nous donna à boire. Plusieurs d entre nous ont vomi. Il était je crois plus de midi. Nous formions un triste spectacle. Les blondes étaient devenues brunes et les brunes toutes grises, nous étions sales, je crois que la peur commençait à me gagner. Je voulais fuir, je ne me souviens plus si j'ai pu récupérer mon vélo resté au lycée, ni comment j'ai rejoint Cognin où je trouvais ma tante toute affolée: une bombe avait été lâchée sur une ferme des alentours, il n'en restait rien.
Chambéry brûlait
Ce que je sais c'est que je n'ai pas pu rester à Cognin, je suis descendue à Chambéry : il fallait que je voie je me demandais si ce que j'avais vécu était bien vrai. A Chambéry j'allais de-ci, de-là, la ou l'on pouvait aller: Chambéry brûlait. Dans les caves de la rue Saint-Antoine des personnes appelaient, le feu sur la tête, les pieds dans l'eau, je crois qu'il y a eu des victimes. Je glanais de ci de-là, des renseignements sur le lycée bien sûr. Je n'ai retrouvé aucune de mes camarades, les familles étaient venues les récupérer. Légende ou réalité, des bruits couraient : cinq morts au lycée de filles, pas d'élèves mais la cuisinière et une aide de cuisine, remontées des abris pour assurer le repas. On disait même que la cuisinière en congé, elle mariait sa fille, était revenue peu avant le bombardement pour trouver la mort dans sa cuisine. Est-ce vrai? Est-ce faux?
La Sous-économe était revenue de l'école annexe de l'École Normale pour chercher et mettre à l'abri les cartes d'alimentation des internes normaliennes. On l'a retrouvée sous la véranda du bâtiment effondré côté internat. Dans les abris la surveillante générale d'internat a eu la poitrine écrasée par un bloc traversant les fameuses lucarnes, la 5ème victime je ne sais pas.
Pas de téléphone, des informations circulaient en tous sens
C'est fou les bruits qui ont couru. A une époque où il y avait très peu de téléphones, une tante habitant Ugine, informait mes parents à Chamoux sur Gelon que j'avais été isolée dans un coin. Les bruits circulaient à une vitesse folle, déformés à chaque relayeur.
Le lendemain je regagnais Chamoux à vélo, Chambéry brûlait encore. Nous étions en vacances le 26 mai 1944. Qu'il était long à trouver le sommeil! A chaque passage d'avions la nuit, je tremblais tant, que mon lit tambourinait sur la cloison et réveillait toute la maison. Je devais me lever et marcher dans la chambre.
Plus de 60 ans plus tard, lorsque j'entends passer un avion ou un hélicoptère il faut que je le voie pour être complètement rassurée.
Aujourd'hui je crois qu'il n'y a pas eu un, mais des bombardements multiples, ce jour là à Chambéry: suivant l'endroit où l'on se trouvait, suivant ce que l'on a vu, suivant ce que l'on a entendu, suivant sa propre sensibilité tout est différent. Une camarade de Chamoux élève à Jules Ferry sollicitée avec ses camarades pour aller aider à dégager les abris sur les boulevards ne veut toujours pas en parler : on a dit qu'il y aurait eu 200 morts dans ces abris. Je remercie encore les personnes qui ont aménagé les abris sous l'internat. Les bombes ont éclaté dans le bâtiment et non dans les caves. Quel carnage évité !
Ce petit oiseau qui chantait si joliment a été pour moi un détonateur, la vie était là à côté on devait en réchapper.
Roberte, interne, habitait Chamoux sur Gelon.
Roberte à aussi raconté :
la vie au lycée - en internat-, au fil de ces longues années de guerre
La rentrée de septembre 1943
- Normalement j'aurais dû être inscrite à l'école Jules Ferry. Venant du cours complémentaire de Chamoux sur Gelon, je n'avais qu'une seule langue étrangère : l'italien.
- Jules Ferry, n'ayant pas de classe anglais 2ème langue débutant, au niveau de la seconde, me dirigea vers le lycée de jeunes filles de Chambéry. Ayant obtenu plus de 12 de moyenne au brevet élémentaire j'ai pu intégrer la classe des normaliennes; nous étions 4 élèves dans ce cas désigné par le terme: «assimilé aux normaliennes» qui pour la plupart n'avaient appris qu'une seule langue l'italien à cause de la proximité de l'Italie.
- Le Lycée présente la forme d'un U très étiré, la base s'appuyant sur le parc du Verney. L'aile de l'internat longeait l'avenue Pierre Lanfrey, l'aile- classe amphithéâtre et laboratoire- se trouvait près du Lycée de garçons.
L'École Normale occupée par la Kriegsmarine
- Le régime de Vichy avait décidé d'intégrer les normaliennes aux élèves du Lycée : il réalisait une économie d'enseignants. Elles étaient intégrées au lycée depuis 1941 - 1942. Nous formions une classe appelée classe de M2 pouvant prétendre passer le BAC avec une seule langue: italien ou anglais.
- Les locaux de l'École Normale, rue Marcoz étant libérés furent occupés par les troupes étrangères en 1943, il s'agissait d'officiers allemands, nous disions de la Kriegsmarine, au costume bleu foncé. Bien entendu les dortoirs des normaliennes furent vidés de ses internes, elles purent s'installer dans les dortoirs du lycée. Se trouvant dans le périmètre sensible de la gare, l'internat avait été fermé pour les internes lycéennes qui logeaient en ville chez des correspondants. Je dormais moi chez une grande tante à Cognin, je faisais le trajet à bicyclette matin et soir. A midi je mangeais dans un restaurant rue Jean-Pierre Veyrat. C'était un internat très émancipé pour l'époque.
Après-la guerre, Sainte-Hélène
Par la suite, après la guerre, l'internat a fonctionné à Sainte-Hélène dans le quartier de Montjay, nous faisions le trajet matin et soir à travers l'ancien Faubourg Mâché en empruntant la rue des Bernardines avec la fontaine des «Deux Bourneaux», le réfectoire du lycée de garçons fonctionnant dans des baraquements situés dans la cour.
Élisa Compain se souvient à son tour:
Avoir quinze ans en 1944....
Élisa Francaz (épouse Compain), en classe de 3ème
Avoir quinze ans en 1944, c'est avoir connu, plus ou moins, la faim le froid, la misère vestimentaire, des ennuis de santé bénins ou graves, c'est avoir éprouvé la méfiance et la peur. Et pourtant, à Chambéry, nous étions privilégiés par rapport aux habitants des grandes villes qui connurent une pénurie bien plus grande ou à ceux des centres stratégiques qui subirent tant de bombardements.
La nourriture
En tant que J3, nous avions droit à des rations de 350 g de pain par jour, de sucre par mois, un peu de viande, de beurre, de fromage, et, de temps en temps, un « ersatz » de bonbons à la saccharine ou un quart de litre de lait écrémé.
Les rations de pain peuvent sembler énormes aujourd’hui, même si certains tickets servaient à des achats de farine pour quelque extra culinaire. Mais ce pain noirâtre et indigeste était la partie la plus nourrissante de notre alimentation et pour éviter les chamailleries entre frères et sœurs, certaines mamans pesaient quotidiennement les rations des membres de la famille.
Pommes de terre, haricots secs très appréciés étaient devenus des denrées rares et ceux qui n avaient ni parents à la campagne, ni les moyens d'acheter au marché noir devaient souvent se contenter de raves ou de bettes cuites à l'eau.
Nous avons apprécié les distributions qui, à la récréation de 10 heures venaient calmer nos fringales: en 1943, du lait en poudre allongé de beaucoup d'eau ou du chocolat avec fort peu de cacao, en 1944, des biscuits à la caséine un peu plâtreux mais consistants.
Dans l'ouvrage « Cent ans, du lycée de jeunes filles au collège Louise de Savoie » page 125, description très colorée des menus à l'internat pendant la guerre par Renée Bellot (Troillard) élève de 1940 à 1947.
Le froid
Les hivers de la guerre furent, je crois, particulièrement froids: la Leysse était gelée ainsi que l'étang de Bissy qui tenait lieu de patinoire.
Les rations de charbon étaient réduites et la qualité généralement médiocre: la tourbe extraite des marais aux environs de Chambéry n'apportait guère de chaleur, l'anthracite des mines d'Aimé contenait beaucoup de pierres qui, à défaut de brûler, maintenaient un volant de chaleur quand le feu était éteint.
La plupart des familles vivaient entassées dans la cuisine et la chaleur animale compensait partiellement le carences du chauffage. Dans les autres pièces, l'hiver, les vitres étaient obstruées par le givre qui dessinait d'artistiques feuillages. Le soir, une bouillotte parvenait à tiédir le lit, mais elle refroidissait et l'on se recroquevillait «en chien de fusil» pour profiter de sa propre chaleur. Que le réveil était brutal pour la dormeuse remuante qui allongeait un pied vers le fond du lit glacial et qu'il était dur de se tirer de cet espace réduit mais tiède pour affronter le froid matinal!
Au Lycée, dans la plupart des classes, les radiateurs électriques dispensaient pendant un quart d'heure une chaleur brûlante puis s'éteignaient pour une heure ou deux. Le bâtiment principal avait le chauffage central au charbon et, aux périodes les plus froides, la température dans les salles d'étude et les bureaux ne dépassait pas 11 à 12 degrés.
Vêtements et chaussures
Malgré les restrictions, nous et les « bons » donnant droit à l'achat d'un vêtement neuf (de très mauvaise qualité) étaient rares. Alors, les mamans s'ingéniaient: un large ruban de velours servait à allonger une jupe ou à élargir un manteau; avec de la laine détricotée de deux pulls usés, elles en faisaient un troisième a dessin bicolore, car il ne fallait surtout pas «que cela paraisse être une rajouture»!
Et ces vêtements, nous les portions usés jusqu'à la corde: mise sens devant derrière- une jupe élimée par une selle de vélo (au point d'être rendue transparente) pouvait encore tenir quelques mois. Et les heure: consacrées au raccommodage, notamment des fameuses chaussettes obligatoires au Lycée! Les lessives médiocres, les savons sableux agressaient ce linge devenu si rare.
Pour les chaussures, c'était plus difficile encore. Il fallut donc supporter les souliers devenus trop petits et peu étanches, les galoches en mauvais cuir et à semelle de bois trop tendre qui s'usait si vite.
Toute propension à l'élégance n'était pourtant pas bannie. Il existait des sabots plus chics, avec des semelles aux couleurs vives. Quelques privilégiées, grâce à des trocs sans doute, pouvaient exhiber des vêtements de qualité, en bon état et à la mode: veste longue à épaules carrées, jupe ample mais courte.
Mais toutes essayaient de paraître le moins minables possible. Aucune élève ne serait allée au Lycée avec des habits déchirés, par souci de correction mais aussi parce qu'un vêtement non réparé est trop vite en lambeaux. Le dimanche, chacune mettait ses meilleurs habits, son plus beau calot ou, mieux son chapeau, car les chapeaux restaient en vente libre: ceux qui étaient à la mode en 1944 ressemblaient aux chapeaux d'Artémise et Cunégonde Fenouillard.
Les problèmes de santé
L'hiver entraînait un cortège de rhumes et de sinusites rebelles à toutes les gouttes nasales noirâtres et nauséabondes. Le froid et sans doute les carences alimentaires favorisaient les engelures: ah! les oreilles brûlantes, les orteils gonflés comprimés dans les chaussures trop petites, les doigts transformés en petits boudins douloureux! Seul remède: baigner les engelures dans l'eau de cuisson des céleris (légumes en vente libre)... Il y eut aussi au Lycée quelques cas de gale, pudiquement qualifiée de « gale du pain ».
Avec la mauvaise alimentation se multipliaient les affections diverses: caries dentaires, éruptions exacerbées par des savons trop abrasifs, ennuis digestifs souvent simplement désagréables mais parfois graves avec des jaunisses, des appendicites, des péritonites (une lycéenne en est morte en 1944).
Par contre, il n'y eut, au Lycée, que quelques cas de primo-infection tuberculeuse alors que la maladie a fait des ravages parmi les étudiants.
La méfiance et la peur
Nous avions appris à taire les choses importantes.
Ne pas se vanter des moyens employés dans la famille pour se procurer un peu plus de nourriture: parents à la campagne pour beaucoup, marché noir sans doute pour d'autres.
Ne pas répéter au Lycée les réflexions peu amènes entendues à la maison à propos du gouvernement.
Ne pas citer les messages souvent amusants de la radio anglaise dont l'écoute était interdite.
Ne pas raconter qu'un cousin parisien requis par le STO était hébergé chez nous ou qu'une amie de la famille avait été incarcérée à la caserne Curial parce que son mari faisait de la résistance.
Ne pas évoquer cette villa de la rue François Charvet avec des cellules d'1,50 mètres de côté aménagées dans la cave et des salles «d'interrogatoires» au dessus.
Ne jamais parler des parachutages d'armes ou des sabotages dont nous avions eu l'écho, car des informations circulaient, fragmentaires, entre gens de confiance mais ne devaient pas filtrer à l'extérieur. En effet, nous savions beaucoup de choses concernant des activités clandestines.
Nous savions aussi que le destin est souvent aveugle, que des balles qui ne vous étaient pas destinées blessaient ou tuaient: nous en connaissions des victimes.
Nous savions que des villes pouvaient être bombardées: Modane, Annecy l'avaient été. Pourtant pendant les alertes nous n'y croyions guère et nous échangions des plaisanteries dans les abris. Pourtant quand les bombes sont tombées, même celles qui, comme moi, ont assisté d'un peu loin au bombardement, ont frémi, sentant la mort, là, toute proche.
Car nous avions peur de la mort, bien sûr, peur aussi d'un avenir que nous n'osions pas imaginer.
Nous avons appris que rester en vie tenait parfois à peu de choses. Nous avons appris la prudence, l'horreur du gaspillage, celui de la nourriture ou des vêtements, mais aussi de tout ce qui pouvait resservir: un bout de ficelle, un morceau de papier. Nous avons appris un certain fatalisme: envoyés à la campagne pour éviter un éventuel deuxième bombardement de Chambéry, nous avons côtoyé plus de dangers que si nous étions restés chez nous Nous avons appris que l'opportunisme, la lâcheté existaient mais aussi la générosité et le courage. Nous avons appris que la brutalité et la sauvagerie pouvaient dépasser tout ce que nous pouvions imaginer.
Des traces indélébiles?
Les années sombres, au sens propre comme au figuré.
Depuis la déclaration de guerre, la défense passive veillait à ce que, la nuit, les avions ennemis ne puissent pas repérer, grâce aux lumières, les zones habitées. Dès la tombée du jour, les fenêtres ne devaient plus laisser passer la moindre lueur: il avait fallu obturer les fentes des volets avec des papiers de couleur sombre. peindre en bleu les fenêtres sans volets (des traces en ont subsisté jusqu'au déménagement de 1988 dans le bâtiment des Archives départementales). Dans les rues, les lampadaires diffusaient une chétive lueur bleuâtre.
Dans les maisons, souvent les pièces étaient éclairées par une unique ampoule et lors des baisses de tension le filament rougeoyant n'éclairait guère. Et lors des coupures de courant, faute de pétrole, il fallait recourir à des lampes à carbure dont les joints peu étanches laissaient filtrer des gouttes d'eau qui déclenchaient des mini explosions. Ceux qui n'en possédaient pas ou ne pouvaient se procurer du carbure s'éclairaient à la bougie ou, plus sommaire au «rat de cave», filament enduit de stéarine ou succédané.
Se déplacer
Les autos n'étaient pas très nombreuses avant la guerre et en 1939 l'armée en avait réquisitionné, en particulier les tractions Citroën. Par la suite, seules avaient été autorisées à circuler, uniquement les jours ouvrables, celles qui étaient utiles à des professionnels. Mais les rations d'essence de plus en plus réduites obligeaient, par exemple les médecins, à circuler à bicyclette pour des visites à domicile: j'ai ainsi vu le docteur Belly arriver un matin d'hiver, chapeau et pardessus couverts de neige après un parcours de plus de 3 km.
On vit réapparaître quelque fiacres. Pour des transports dans Chambéry et environs immédiats, la société Blache utilisait des voitures tirées par un cheval, de même que l'entreprise Davignon pour livrer des pains de glace aux nombreux commerçants qui ne possédaient pas de frigorifique. Pour des livraisons moins lourdes, les « express chambériens » pédalaient sur des bicyclettes traînant une remorque. Des camions équipés de gazogène faisaient des transports à moyenne distance: il n'était pas question de déplacements plus lointains.
Pour les personnes, une ligne d'électrobus joignait Chambéry à Challes. Il existait aussi des entreprises de cars qui reliaient les principaux chefs-lieux de canton à Chambéry ou à la plus proche ville voisine. Ces cars étaient généralement bondés au delà des limites de sécurité et des voyageurs étaient entassés dans le couloir, obligés parfois de se tenir sur un seul pied pendant des kilomètres....
On a vu aussi des jeunes gens installés sur le toit au milieu des bagages.
Les trams étaient également pris d'assaut malgré l'inconfort de wagons vétustés aux banquettes de bois, mais les voyageurs y étaient tout même moins serrés que dans les cars. Gros avantage, les trains pouvaient aussi transporter les vélos, indispensables pour parcourir les campagnes à la recherche d’un peu de ravitaillement.
Aux beaux jours c’était dans les villages un défilé de cyclistes, sportifs involontaires, essayant d'acheter ici ou là, quelques œufs, des haricots secs, du vin ou de troquer une paire de sandales ou un vêtement « presque neuf » contre de l’huile, de la « gnôle » ou du tabac. Encore fallait-il au retour, éviter le regard suspicieux du contrôleur du ravitaillement. Jusqu’en 1941 ou 42, on put (difficilement) se procurer des vélos de médiocre qualité, mais il n’était plus question d’en acheter de neufs en 1944.
Les pneus, surtout ceux des années de guerre en caoutchouc «artificiel» ( ?) s’usaient sur les toutes de campagne souvent simplement empierrées. Il fallait les «gonfler à bloc» et s’ils éclataient un rechapage sommaire leur permettait de durer encore un peu. Il s’est vendu des boudins métalliques qui s’avérèrent peu fiables. Si bien qu’on a vu des cyclistes rouler sur les jantes ! Et ne parlons pas des freins peu efficaces, des dérailleurs qui se coinçaient dans les rayons des roues. Et pourtant, ils en ont porté, des chargements, ces vélos : le petit dernier de la famille sur une selle vissée sur le cadre de vélo du Papa, un cageot sur le porte-bagage arrière, deux sacs au guidon !
La bicyclette était plus que jamais la «petite reine».
Attendre
À chaque fin de mois, attendre au secrétariat de mairie la distribution des tickets pour le mois suivant : l’un des employés contrôlait la carte d’alimentation et les autres délivraient tour à tous les tickets de pain, de matières grasses, de viande, de « denrées diverses ».
Les attentes étaient longues dans les magasins car les commerçants devaient découper les tickets puis peser les rations au plus juste (plutôt moins que plus chez tel ou tel, disaient les esprits chagrins). Il fallait donc attendre: tous les matins, à la boulangerie pour le pain quotidien, à l'épicerie pour le quart de litre de lait du J2, ou deux ou trois fois par mois, pour quelques dizaines de grammes de beurre, attendre en fin de semaine à la boucherie pour un peu de viande coriace.
Attendre au guichet de la gare, au départ du car, au cinéma...Que d'heures passées à «faire la queue»!
Et bien sûr nous avons attendu impatiemment le débarquement allié, puis la Libération, l'armistice (Ah! Ce joyeux monôme en cette matinée du 8 mai 1945 et, le soir, la liesse dans la rue de Boigne, en dépit des ruines du bombardement, et en dépit de la guerre qui continuait dans le Pacifique). Les prisonniers de guerre et leur famille ont longuement attendu leur retour. Attente qui fut souvent vaine pour les déportés et, pour ceux qui revinrent, décharnés et si faibles, attendre un lent et incertain rétablissement.
Pendant plusieurs années, il a fallu attendre la fin des restrictions et attendre plus longtemps encore la reconstruction des ruines de longues années, une longue patience...
Le patriotisme officiel
Chaque lundi matin avait lieu le « salut au drapeau ». Classe par classe, nous nous rangions sur trois côtés de la cour de l'externat. En face, se dressait un mât tricolore et, à tour de rôle, les deux meilleures élèves de chaque classe hissaient le drapeau au moyen d'une corde et de poulies.
La Directrice, Madame Carteron nous adressait un petit discours, mais sa voix était faible et, malgré notre silence, nous n'en percevions que des bribes nous exhortant au travail, à la franchise, etc.
Nous chantions un couplet de la Marseillaise, le drapeau était redescendu et, en rang, nous montions dans nos classes.
Aux beaux jours, la cérémonie n'était pas désagréable, mais en hiver, il fallait rester immobile dans le froid.
Madame Carteron avait très vite le nez rouge et les yeux larmoyants, tandis qu'à ses côtés, Mademoiselle Déclert, la Surveillante Générale, semblait insensible aux intempéries.
Un jour, la cérémonie se termina dans la cacophonie: tandis que sous la direction du professeur de musique nous chantions docilement « Amour sacré de la Patrie... », quelques grandes élèves entonnèrent le premier couplet de la Marseillaise. Naturellement, nous eûmes droit à un chapitre de morale, d'autant plus que la Directrice venait d'insister sur la nécessité de l'ordre et de la discipline (à ce qu'on nous en dit, car nous n'avions pas mieux entendu qu'à l'ordinaire).
La plupart d'entre nous n'avaient rien compris à l'affaire, mais quelques élèves mieux renseignées nous expliquèrent: le premier couplet (entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats) passait pour gaulliste tandis que l'autre avait la préférence du Maréchal Pétain.
Suivant les consignes officielles, le portrait du « Maréchal » trônait au dessus du bureau dans chaque salle de classe. Nous en avions l'habitude depuis la classe de 6ème et nous ne le remarquions même plus. L'administration et les professeurs appliquaient les ordres reçus, sans zèle excessif; me semble-t-il. Ainsi, lorsque, entre 1940 et 1942, tous les écoliers durent envoyer une lettre ou un dessin au Maréchal, au Lycée, personne ne nous obligea à le faire et l'on mit simplement une boîte aux lettres à notre disposition. Je ne pense pas qu'il y eut beaucoup d'œuvres déposées.
Par contre, lorsque des portraits de Pétain furent subtilisés dans quelques classes, la Directrice intima aux coupables l'ordre de les remettre en place -sans résultat, vraisemblablement.
Dans son discours de la distribution des prix en juillet 1945, Madame Carteron rapporta un incident ignoré jusque là. Dans le parloir, «le portrait du Maréchal coupant les motifs triangulaires de la tapisserie fut entouré de V séditieux ; pour cela, notre Lycée fut taxé de gaulliste et une enquête fut ouverte»2
mai 2015 - Témoignages Roberte Burnier et Élisa Compain. Mise en ligne A.Dh.
Sources
1- Le Lycée sous les bombes - des lycéennes racontent l'Occupation - publication de l'Association des Anciennes élèves du Lycée Louise de Savoie de Chambéry - achevé d'imprimer / dépôt légal oct 2008
2- Archives départementales de Savoie 994 W14.
Nous remercions Roberte et Élisa qui nous ont communiqué ce document, et ont accepté que nous en tirions leur témoignage. Pour plus d'informations sur l'Association des Anciennes élèves du Lycée Louise de Savoie de Chambéry : Collège Louise de Savoie, Chambéry
Août 1944
Le Réveil 1944
AOÛT 1944 - LE PASSAGE DES HORDES ALLEMANDES À CHAMOUX-SUR-GELON
Le mois d'août, pour notre commune, a commencé tragiquement. Après une vogue sans pain ni viande dans les boulangeries et boucheries, le mardi matin, Chamoux était cerné par les Allemands. Ils commencèrent par brutaliser plusieurs personnes puis convoquèrent tous les hommes dans la cour des écoles. Cette "vérification de papiers" se termina par une harangue au cours de laquelle on nous présenta comme terroriste dangereux un jeune homme des plus calmes du pays. Sa figure tuméfiée et sa chemise déchirée nous renseignèrent suffisamment sur la prétendue correction de ces tristes individus. Dans la soirée, fut retrouvé dans une grange au-dessus du village de Montendry, le cadavre de notre compatriote Félicien Aguettaz. Il était méconnaissable. Le même jour un Israélite fut arrêté, dont on retrouva le corps neuf jours plus tard sur la route dépouillé du linge et de l'argent qu'on lui avait dit d'emporter.
LES INCENDIES S'ALLUMENT
Secteur calme jusqu'au 22, sauf la disparition du car nous reliant à Chambéry. Le chauffeur est revenu blessé. Pourtant on sent de l'énervement chez les occupants et la nuit est troublée par le passage de convois sur la route de Maurienne.
Dans la matinée du 22, la réquisition se fait exigeante : il faut immédiatement des attelages avec des conducteurs pour débarrasser le fort d'Aiton. De nos trois compatriotes partis ce matin-là, nous fûmes sans nouvelles pendant huit jours : après être montés jusqu'au versant italien du Mont Cenis en étapes nocturnes à la lueur des incendies, ils furent ramenés en France et considérés comme prisonniers. Leurs gardiens leur firent piller des fermes aux environs d'Epierre. Ils réussirent à prendre le large et sont tous rentrés, heureux d'avoir la vie sauve, mais écœurés de ce qu'ils ont vu.
Le 22 août après-midi, la présence de femmes dans la rue fit échouer à Bourgneuf un coup de main de l'A.S. contre les Allemands en quête de bicyclettes. Un quart d'heure après, le centre de Bourgneuf recevait des projectiles incendiaires. La chaleur, le fourrage engrange, l'arrivée tardive des pompes, tout cela aida le feu à se propager rapidement. Huit ménages sont dans la misère. Rien ne fut sauvé chez M. Lavoine, parti le matin même en voyage forcé vers l'Italie. Vers le pont de Bourgneuf, la maison Aguettaz fut incendiée par deux soldats ivres. Et pendant que le feu faisait rage l'équipe pillait le quartier de la gare de Chamousset ; ils firent de même dans les trois jours suivants dans les maisons restées debout au hameau de l'Eglise de Bourgneuf. Hommes et enfants, en grande majorité, montèrent se réfugier à Môntendry et à Champlaurent.
Jeudi 24 de bon matin, le fort d'Aiton fit explosion. Une colonne de fumée s'élevait bientôt aussi de Châteauneuf. Une bonne nouvelle pourtant : dans la soirée, 68 ennemis se rendaient au-dessus de Bettonnet.
VOICI LES AMERICAINS !
Vendredi 25, des rafales se faisaient de plus en plus distinctes.
D'un instant à l'autre, nous attendions les Américains signalés vers midi à La Rochette puis à Villard-Léger.
 Dans la nuit des gerbes de flammes du Villard d'Aiton éclairent lugubrement la vallée. Mais les Américains étaient là. Une vive fusillade éclata vers 2 heures du matin. Puis on entendit une forte détonation, bientôt suivie d'une autre formidable, qui fit trembler les maisons : le pont d'Aiton et le pont Royal venaient de sauter. Comme à un signal, tout bruit cessa, et la nuit s'acheva dans un silence lourd d'anxiété. Pourtant, quand le jour arriva, nous étions débarrassés.
Dans la nuit des gerbes de flammes du Villard d'Aiton éclairent lugubrement la vallée. Mais les Américains étaient là. Une vive fusillade éclata vers 2 heures du matin. Puis on entendit une forte détonation, bientôt suivie d'une autre formidable, qui fit trembler les maisons : le pont d'Aiton et le pont Royal venaient de sauter. Comme à un signal, tout bruit cessa, et la nuit s'acheva dans un silence lourd d'anxiété. Pourtant, quand le jour arriva, nous étions débarrassés.
Le Pont-Royal bombardé. (Document photo ajouté : www.ac-grenoble.fr)
L'article n'est pas signé.
Recherche Bibl. dioc. St Jean de Maurienne / Transcription A.Dh.
Source : Le Réveil, été 1944
(Le Réveil, « quotidien catholique de la Résistance du sud-est », né le 1er septembre 1944 sur les presses grenobloises de l’ex Sud-Est suspendu à la Libération. Il disparaît en février 1952.) cf http://museedelaresistanceenligne.org
Réquisitionnés, 1944
Août 1944 aux Berres
Réquisitionnés !
L'enregistrement :
Cliquer pour écouter
Transcription :
«En août 44, mon père a été réquisitionné par les Allemands avec mon oncle, et Émile .…(3 gars des Berres).
Ils ont été réquisitionnés avec les chevaux et les chariots pour transporter du matériel allemand du Fort d’Aiton, vers l’Italie.
Ils ont chargé au Fort d’Aiton, et ils sont partis avec la colonne des Allemands (ça commençait à aller pour mal pour les Allemands, c’était le début de la débâcle).
Quand ils sont arrivés au pied du Mont-Cenis (il n’y avait pas le tunnel à l’époque 1), les chevaux n’en pouvaient plus : du Fort d’Aiton jusqu’au Mont-Cenis, ça fait long 2 [surtout qu’elles étaient chargées. Ils n’ont pas sauvé les bêtes, elles sont restées au pied du Mont-Cenis.]
Ils ont tout laissé là-bas, les chevaux, l’attelage, tout ; et ils ont eu l’autorisation de rentrer ; le capitaine allemand qui s’occupait d’eux – entre autres – leur a donné un papier : « ces 3 hommes ont rendu service à la Wehrmacht 3, je vous demande d’en prendre soin pou leurretour chez eux ».
[Il parlait bien français ; il leur a dit « Surtout, ne passez pas par la forêt ! »]
Donc ils ont tout refait à pied, du Mont-Cenis jusqu’à Épierre ; présentation des papiers : bon ! Mais à Épierre, ils tombent sur les S .S. qui eux, n’entendent rien. Ils sont restés là, à Épierre, et ils avaient commencé à creuser leur tombe.
Heureusement, en même temps, les Américains arrivaient par derrière, de Pontcharra : il y a eu une vraie attaque sur le village d’Épierre, attaque américaine (peut-être avec des maquis français : il y avait des maquis partout, tout alentour dans la vallée).
Panique, tout le monde a giclé dans tous les sens, et… nos 3 habitants des Berres en ont profité : ils sont partis aussi ! et ils sont rentrés.
Ça avait bien duré 4 jours, on était en souci : on n’avait pas de nouvelles; à l’époque il n’y avait pas de communications !»
N.G.
Notes
1- Le tunnel routier du Fréjus, a été mis en service en 1980 ; seul existait alors le tunnel ferroviaire. Le col du Mont-Cenis relie la vallée de la Maurienne, au val de Suse, en Italie à 2 081 m. d’altitude.
2- 130 km séparent Aiton (alt. 290m) de Lanslebourg (alt 1400m).
3- Wehrmacht : nom porté par l’Armée du IIIe Reich à partir du 21 mai 1935 et jusqu'à sa dissolution officielle en août 1946
/chamoux/sites/chamoux/files/media/01_patrimoine_requisition1.mp3
Prisonniers KG en 46
Après l’armistice de 1945:
Des prisonniers de guerre allemands à Chamoux
"Ils étaient une quinzaine de prisonniers de guerre stationnés – « administrés » - au 2e Berre."
Prisonniers de guerre
"Ils étaient rassemblés dans une maison inoccupée au 2e Berre. Ils avaient dû être placés (par l’État, par la Préfecture?) : il fallait bien en faire quelque chose, de ces prisonniers… et c’est un conseiller municipal du 2e Berre qui leur avait trouvé ce « gite ».
Ils étaient placés chez les gens qui avaient besoin: des agriculteurs en demandaient.
Ils avaient pensé à une évasion mais c’était difficile car ils portaient la marque KG1 des prisonniers, et ils étaient surveillés. Pour Noël, ils avaient tout garni la maison avec des guirlandes; mais ils avaient l’envie de f.… le camp le soir : ça s’est su, et ils ont été coincés, ils n’ont pas pu partir.
Il y en a un qui venait chez mes parents : c’était un tailleur tchèque, il venait chez nous parce qu’on avait une machine à coudre Singer, et il cousait des affaires, et il était très gentil. Dans ce groupe, il y avait également un ingénieur, un architecte, un chef-cuisinier, etc."
Un crime
Mais celui qui a tué cette pauvre femme… il a été pris sur le fait.
C’était un de ces prisonniers de guerre, il travaillait tous les dimanches chez une dame du 1er Berre : il faisait le jardin, des travaux. Vint la libération pour ces Allemands. Cette dame avait de l’argent, et il le savait.
Un jour, il est rentré par derrière pour « piquer » de l’argent pour rentrer chez lui: il connaissait parfaitement les lieux puisqu’il était venu souvent. Malheureusement, la dame qui allait partir à Chamoux chez sa sœur où elle était invitée à manger – c’était un dimanche – l’a vu dans l’armoire à glace ; il a paniqué et il l’a tuée.
L’enquête a été assez rapidement menée, il y avait quelques indices, il a été identifié, et il a été «cueilli» au moment où il prenait le train pour porter ce qu’il avait volé à sa femme et à sa fille.
Il a été jugé, et condamné à 15 ans - je crois – pour meurtre à Chambéry ; après, il a été extradé en Allemagne ; on a appris qu’en Allemagne, il n’avait pas fait toute sa peine ; c’était "logique"…
Au quotidien
Ils n’étaient pas malheureux ces prisonniers de guerre, ils étaient bien acceptés par la population: c’était après 1945, la guerre était finie; ils allaient chez les uns et les autres, dispatchés un peu partout, pour ceux qui les demandaient, pour aider ; et les familles les faisaient manger…
Ils étaient habitués à certaines maisons, et ils y revenaient facilement – je me souviens de ceux qui venaient à la maison, dont on avait l’habitude ; mais il y en avait d’autres…
Après la Libération, l’un d’eux a fait un courrier adressé aux villageois, il remerciait les habitants pour leur accueil, leur hospitalité.
Ah c’est loin tout ça… et il y a des choses qui échappent…
Mai 2016, R.G.
1- KG : Kriegsgefangener ~ prisonnier de guerre (Krieg ~ guerre, der Gefangene ~ nom masc. : prisonnier, du verbe fangen ~ attraper)
Note, pour compléter un peu, sur ce point rarement évoqué
Extrait d’un « dossier documentaire destiné aux élèves des classes de troisième, première et terminale des établissements scolaires du second degré du département du Gers.»
à lire sur http://sdonac32.pagesperso-orange.fr/44-45.htm
Les prisonniers de guerre allemands en France
En novembre 1945, le nombre de prisonniers de guerre allemands détenus en France, dans des camps français, dépasse le million. Près de 300 000 ont été capturés, depuis l'origine, par les forces françaises, tandis que plus de 700 000, qui ont été faits prisonniers pour l'essentiel par les Américains, ont été remis aux Français.
En effet, la France a besoin de main d’œuvre. Entamant la reconstruction de ses infrastructures et la restauration de ses capacités agricoles et industrielles largement détruites par la guerre, la France utilise les prisonniers de guerre allemands, en les affectant, souvent au sein de commandos de travail, dans les secteurs les plus divers de son économie.
À cette époque, les Français connaissent de graves pénuries, notamment vestimentaires et alimentaires, aggravées par d'énormes difficultés dans le domaine des communications et des moyens de transport. De fait, les prisonniers de guerre allemands subissent aussi les mêmes privations. Toutefois, leur situation est parfois rendue meilleure quand des employeurs généreux sont en mesure d'améliorer leur alimentation. D'autres Français ont, au contraire, des réactions d'hostilité à leur égard et adoptent une attitude plus rigoureuse.
Quoiqu'il en soit, les derniers prisonniers de guerre allemands seront libérés par les Français en 1949.
