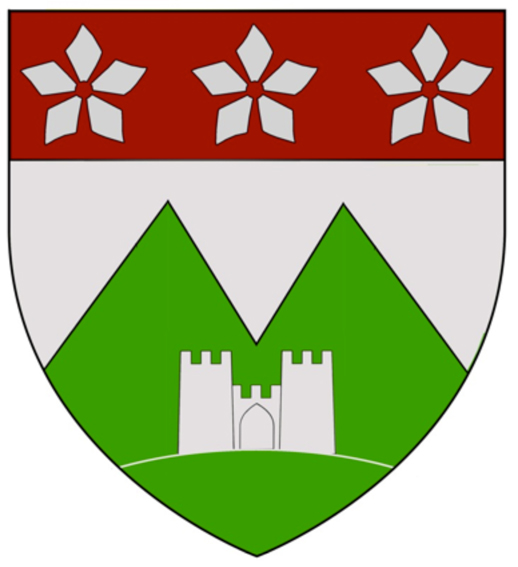1918 , une normalienne face à la grippe espagnole
En 1918, je devais entrer à l'École Normale de Chambéry au 1er octobre.
Mais une épidémie sévissait, et la rentrée des internats fut reportée à plus tard.
Des affiches étaient apposées partout, donnant des conseils pour éviter cette maladie inconnue jusqu’alors, qu’on appela “grippe espagnole”.
La maladie s’étendait partout, même dans la campagne. À Chamoux et même à Villardizier, plusieurs personnes en furent atteintes et moururent sans qu’on ait pu trouver un remède efficace.
On conseillait l’huile goménolée à mettre dans le nez, ce qui se révéla complètement inefficace. On pensait aux anciennes épidémies de choléra ou même de peste, mais les symptômes étaient différents, et la nouvelle maladie paraissait tout de même moins effrayante. On accusait la guerre, avec son mélange de populations dans les armées, mais sans savoir rien de précis.
J’étais donc restée à Chamoux, où mon père, à peu près remis des troubles d’estomac qui lui avaient valu d’être réformé, creusait des fossés dans les nouveaux champs des Viorges, que nous venions d’acheter: il voulait planter des treilles en bordure de chaque demi-journal de terre cultivable. Avec cet achat, nous avions eu un petit terrain, ancien jardin resté en friche, où le bois avait poussé. Il fut décidé d’arracher tout ce bois, et de faire de ce terrain un petit verger.
Une petite équipe de jeunes de Villardizier, en congé de convalescence de l’armée, et d’autres qui n’étaient pas encore en âge d’être mobilisés, fut heureuse d’entreprendre ce travail pour gagner quelques francs, ce qui serait tout bénéfice, puisqu’ils étaient nourris chez nous et logés dans leur famille. Ils travaillèrent avec pioches et pelles pour dessoucher toute cette végétation sauvage.
Je fus chargée de faire les fagots, puisque j’étais en congé.
On parlait de cette guerre qui avait trop duré, et qui avait tué ou estropié tant de jeunes. Ceux qui étaient là étaient heureux d’avoir survécu, malgré tant de deuils dans les familles. On parlait d’armistice, sans trop oser y croire.
Mais ce jour-là, ce fut vrai: toutes les cloches des environs se mirent à sonner à la volée pour annoncer cette bonne nouvelle. C’était le 11 novembre 1918.
Les soldats espéraient être rapidement démobilisés et revenir dans leurs villages, où tant de jeunes manqueraient. Ceux des classes suivantes se réjouissaient d’échapper à cette affreuse guerre. Malgré tous les mauvais souvenirs, les gens se reprenaient à espérer. Bien qu’elle fût toujours présente, on croyait que la grippe espagnole allait s’arrêter.
Quelques semaines après l’armistice, l'École Normale de Chambéry fut rouverte : ce fut la rentrée.
L'École Normale, qui avait maintenant repris son rôle, avait été occupée pendant la guerre par un hôpital militaire. Au rez de chaussée, la cuisine était devenue inutilisable. Au premier étage, les salles de classe étaient restées aux Normaliennes. Le deuxième étage avait abrité l’hôpital militaire. Les anciennes cabines des Normaliennes avaient été démolies. Le grand espace qui tenait toute la longueur du bâtiment redevenait dortoir après avoir subi une sérieuse désinfection et un important nettoyage pour détruire toute la vermine: poux, puces, et surtout punaises. Une soixantaine de lits propres y étaient alignés, avec leur petite table, leur cuvette et leur boîte à toilette.
L’eau était aux deux extrémités du dortoir. chacune des trois promotions avait droit le soir à un broc d’eau chaude que l’élève de service pouvait prendre chez le concierge. Il ne s’agissait pas de gaspiller cette eau précieuse et nous nous contentions d’eau froide. Nous n’en souffrions pas, beaucoup de Normaliennes venaient de la campagne, où il fallait se contenter de l’eau du “bourneau” public, qui devenait boueuse les jours de pluie. Et même celles de la ville, quand elles avaient l’eau froide dans l’appartement ou sur le palier se contentaient de ce confort.
Les élèves de première année couchaient au plus près de la surveillante et de la directrice. Le milieu du dortoir servait aux deuxièmes années, et les troisièmes années étaient à l’autre bout, près de la lingerie où se trouvait notre placard à linge et vêtements, protégé par un simple rideau. Il était interdit d’y mettre des provisions, sauf un morceau de pain bien enveloppé, quand nous pouvions en apporter de la campagne. Le pain était encore rationné, et on nous donnait notre part de la journée au petit déjeuner. Nous l’aurions fini sans peine le matin, car le pain était très apprécié malgré sa mauvaise qualité.
Nous prenions nos trois repas au lycée de filles, où nous occupions un côté du réfectoire. Les “bourgeoises” qui occupaient l’autre côté et payaient leur pension, méprisaient parfois ces Normaliennes qui mangeaient sans payer. Notre directrice, qui nous aimait bien, nous encourageait en nous disant de ne pas nous prendre pour des mendiantes: notre pension, nous l’avions payée par notre travail, notre concours d’entrée difficile, et les services que nous allions rendre à l’enseignement après notre scolarité.
Malgré les fréquents lavages du dortoir avec une bonne dose d’eau de Javel, une punaise sortait parfois la nuit d’une jointure du plancher. Il fallait le signaler, et les élèves de service au dortoir recommençaient le lavage du plancher. L'École Normale toute entière était entretenue propre par les élèves, en groupes de deux, selon la répartition du travail. Le service de propreté était exécuté après le repas de midi. Les lycéennes qui, pendant ce temps, se promenaient en rang sous la surveillance d’une “pionne”, se moquaient de nous, condamnées à des tâches serviles. Filles de paysans ou d’autre petites gens, nous préférions notre travail presque libre à la promenade sous surveillance avec costumes et chapeaux d’uniformes. Nous étions fières de travailler librement, en bavardant et en riant, le contrôle du travail ne venant qu’ensuite, sans méchanceté Nous changions de service une ou deux fois dans l’année, pour que toutes, nous soyons capables d’entretenir un maison.
Les salles de classe de l'École Normale étaient éclairées au gaz, que l’élève de service avait la charge d’allumer chaque soir. Ces salles recevaient de l’air chaud de la chaudière à charbon installée à la cave et entretenue par le concierge. L’air chaud montait de la cave, et arrivait dans les classes par des bouches de chaleur, au bas du mur, près de l’estrade. Au moment du décendrage et du chargement en charbon, l’air qui montait était poussiéreux et mêlé de fumée. Le dortoir était également chauffé par des bouches de chaleur aux deux extrémités. Là, ce nouveau confort était apprécié. Chez nos parents, les chambres à coucher n'étaient pas chauffées du tout: la fenêtre était souvent décorée de feuillages de givre, et des paillettes glacées faisaient briller les murs et les poutres du plafond. Les bouches de chaleur étaient dépoussiérées par les élèves de service.
Malgré quelques punaises qui sortaient encore parfois la nuit des rainures du plancher, nous étions plutôt bien. Les serpillières et l’eau fortement javellisée des normaliennes faisaient rapidement disparaître ces petits ennuis.
Chaque dimanche matin, nous devions découvrir complètement notre lit, épousseter soigneusement tous les ressorts du sommier, travail contrôlé par le professeur de mathématiques faisant fonction d’économe, qui circulait dans l’allée principale. L’entretien de notre boîte à toilette était contrôlé aussi. Puis, tout étant en ordre dans le dortoir et dans les salles de classe, les trois promotions de Normaliennes se réunissaient dans la salle où se tenait chaque dimanche le compte-rendu des événements. “Madame”, comme nous appelions notre directrice, présidait ce compte rendu.
Les élèves de troisième année étaient chargées à tour de rôle de lire les nouvelles sur le Progrès de Lyon, auquel l’école était abonnée. Elles devaient y relever les principales nouvelles de la semaine en politique intérieure et extérieure, et en faire le résumé à leurs camarades sous le contrôle de la directrice. la conférence terminée, les élèves qui voulaient aller à la messe de onze heures à l’église de la rue Saint Antoine ou à l’office protestant s’inscrivaient sur un cahier du parloir. les autres étaient libres dans les salles ou, l’été, au jardin, à condition de ne pas faire de bruit. Après le repas de midi et un service de propreté plus sommaire, les deux premières années allaient se promener dans la campagne environnante, sous la surveillance d’un professeur. Nous ne nous mettions en rangs que pour l’entrée en ville. Pour les sorties, nous portions toujours le chapeau d’uniforme, en feutre l’hiver et en paille l’été, mais ces chapeaux duraient plusieurs saisons, avec une petite variante chaque année.
Tous les jours, après le service de midi, à l’heure du goûter et le soir nous avions un quart d’heure de liberté. Le soir, Madame venait rassembler tout le monde pour chanter avant de monter au dortoir où nous faisions notre toilette avant le coucher. Cette vie régulière et bien organisée ne nous déplaisait pas. Comme la rentrée avait été tardive, il fallait beaucoup travailler pour rattraper le retard.
Mais la grippe espagnole qui sévissait toujours vint perturber notre vie scolaire.
Les premières malades furent logées à l’infirmerie. Mais les cas devenant trop nombreux, les malades restèrent au dortoir et l’école fut licenciée. Celles qui n’étaient pas atteintes partirent chez leurs parents.
Malheureusement, je faisais partie du groupe des malades.
Chacune resta dans son lit avec une grosse fièvre et surtout une transpiration abondante. Le docteur Chiron qui, depuis longtemps s’occupait des Normaliennes malades, était aussi désarmé que les autres médecins devant cette épidémie récente. On utilisait l’huile goménolée pour le nez et des gargarismes pour la gorge. Le docteur disait:
”Il n’y a qu’à les faire cuire dans leur jus.”
Madame, très inquiète, passait avec le docteur.
Une nuit, dans le silence, la porte qui donnait sur l’appartement de Madame s’ouvrit sans bruit. Ne dormant pas, je reconnus notre directrice en long peignoir blanc, avec, à la main, une bougie dont elle essayait de cacher la lumière. Elle s’avançait en silence pour ne déranger personne. Tout d’un coup, Yvonne Hugonnier, qui dormait dans le lit voisin du mien, se souleva en criant:
“Un fantôme! Un fantôme!”
La directrice s’étant rendu compte que sa meilleure élève, si polie et si réservée d’habitude, était sous le coup d’une forte fièvre, vint lui parler doucement:
“Dormez, mon enfant, reposez-vous.”
Yvonne accepta de se recoucher.
Se rendant compte du mauvais état de ses malades, Madame continua sa tournée silencieuse, puis, quand le dortoir sembla assoupi, elle se retira, toujours aussi silencieusement.
Je ne me souviens pas combien de jours la grosse fièvre a duré.
Enfin, on commença à aller mieux. Dès qu’il fut possible, les unes après les autres, nous fumes envoyées en convalescence dans nos familles. À ma connaissance, la grippe espagnole n’a pas causé de décès parmi les Normaliennes.
À la fin de l’hiver, un jour, Madame me fit appeler à son bureau. Inquiète au sujet de cet appel, je m’y rendis. Le courrier était toujours apporté au bureau de la directrice, qui l’inspectait sans le décacheter. La lettre était contresignée de mon père, dont je reconnus l’écriture. Mais la directrice avait remarqué qu’elle n’était pas arrivée le même jour que les lettres habituelles. Elle me pria de la décacheter et de la lire à haute voix.
Ma mère m’annonçait le décès de ma grand-mère de Montendry. Je savais qu’elle avait soixante-quinze ans, ce qui paraissait vieux à cette époque, et que, depuis longtemps, elle avait des difficultés respiratoires. La grippe espagnole, qui paraissait déjà moins violente, avait réussi à la faire mourir.
On me prévenait du jour et de l’heure de l’enterrement, sans me demander d’y assister. La directrice, après réflexion et interrogations sur la longue marche à pied pour suivre la charrette qui emmènerait le corps à l’église et au cimetière, me conseilla de ne pas y assister, pour éviter fatigue et dépenses supplémentaires. Les congés de Pâques approchaient, et je pourrais m’y rendre à ce moment.
J’acceptai donc cette conclusion, qui semblait coïncider avec celle de mes parents. Je n’assistai donc pas à l’enterrement. Avant Pâques, puisque la vie ordinaire n’avait pas encore repris après la guerre, mon père décida de fabriquer lui-même la croix en bois de châtaignier imputrescible et verni. Il avait acheté un cœur émaillé avec inscription du nom de ma grand-mère, dates de naissance et de décès. Aux vacances de Pâques, on irait la planter au cimetière. En 1919, cette façon de ne pas oublier les morts était encore très habituelle.
J’accompagnai donc mon père, qui portait sur l’épaule la lourde croix, de Villardizier au cimetière de Montendry, à pied, naturellement, par les raccourcis pentus et rocheux.
Au chef-lieu de Montendry, nous avons frappé chez Alphonse Charrière, qui était probablement encore le maire de la commune. Nous y fûmes accueillis comme les gens de Montendry ont toujours su le faire: avant de nous mettre au travail, il fallut entrer nous reposer un instant près d’un bon feu. Après une conversation amicale, il nous prêta les outils nécessaires au travail car il ne fallait pas trop nous attarder.
Au cimetière, je reconnus tout de suite, à la terre fraîchement remuée, l’endroit où reposait ma grand-mère. À chaque coup que donnait mon père pour enfoncer la croix, il me semblait que nous faisions mal à ma grand-mère qui pourtant était tout heureuse de notre visite car, naturellement, je la voyais vivante.
L’emplacement de la grand-mère en bon ordre, nous allons rendre visite au grand-père qui reposait près de là. Il nous sembla heureux, comme toujours, de notre visite. Et maintenant que la Françon était venue le rejoindre, il se sentirait moins seul. Mais dans ce cimetière de Montendry, on est toujours en bonne compagnie, avec tous ceux qu’on a connus, et avec qui on était lié d’amitié. Tous ensemble dans ce petit coin de terre où on a toujours vécu, on ne peut pas se trouver malheureux.
Quant à moi, j’emporterai un très bon souvenir de ces hivers d’enfance que j’ai vécus chez mes grands-parents. Les morts ont toujours l’air de vivre comme on les a connus. Avec un petit regret de quitter ce lieu, nous reprenons la descente vers Villardizier, où ma mère nous attend avec ma sœur et la seule grand-mère qui me reste, la Babeau.
avril 2020 - Souvenirs de Léonie Francaz, transcrits par sa fille et sa petite fille,Élisa et Françoise Compain