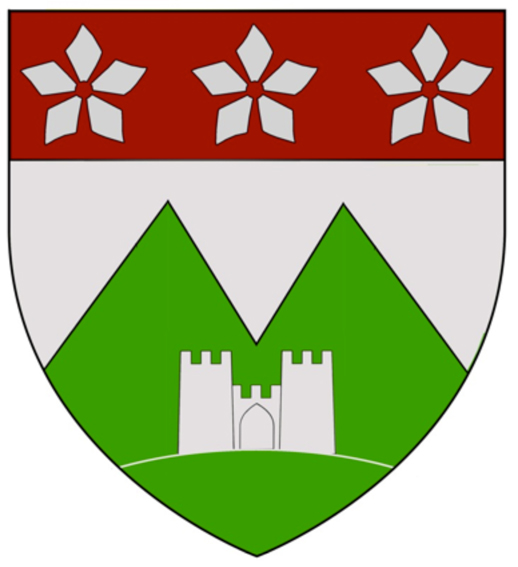Deux lycéennes sous les bombes
En octobre 2008, l'Association des Anciennes élèves du Lycée Louise de Savoie de Chambéry a publié un document précieux: Le Lycée sous les bombes - des lycéennes racontent l'Occupation1.
Anne-Marie Vallin avait en effet réuni et organisé les témoignages d'une vingtaine de camarades, qui furent tout comme elle lycéennes à Louise de Savoie.
Elles vécurent le bombardement du 26 mai 1944.
Parmi elles, Robert Burnier et Élisa Compain ont de fortes attaches avec Chamoux. Elles nous ont transmis leurs témoignages que l'on peut retrouver dans l'ouvrage cité ci-dessus.
Roberte Maître (épouse Burnier), seize ans et demi, en classe de seconde
Ce jour là, le 26 mai 1944
Ce jour là devait être un mardi. Nous avions, les secondes M2, cours de dessin au 2ème étage cote Lycée garçons suivi de 2 heures d'histoire de la littérature avec «mademoiselle Houter français». C'était une journée d'exposés complétés par un plus du professeur. Ce jour là j'avais un exposé avec deux camarades, mon plan était prêt mais je n'avais pas écrit mon texte. Mademoiselle Gerbelot-Barillon professeur de dessin nous a permis de travailler pendant son cours. L'alerte a sonné, nous savions ce que nous devions faire, nous avions déjà vécu plusieurs alertes.
je me souviens qu'il y avait une certaine agitation peu coutumière, pas de la peur, simplement une excitation : pour moi mon texte n'avait guère avancé. Nous nous précipitâmes dans l'escalier, arrêtées au premier par mademoiselle Déclert la Surveillante Générale d'externat qui nous ramena à plus de calme. Nous longeâmes, sous le préau, les classes de la base du U pour nous diriger vers les abris qui se trouvaient, en tout cas pour le nôtre, sous l'aile de l'internat. Nous empruntâmes l'escalier côté cuisine. « La cuisine » était installée dans un petit bâtiment dans le prolongement de la base du U en direction de l'avenue Pierre Lanfrey.
Les caves avaient été très bien aménagées, des murs avaient été construits en chicane, le plafond renforcé par des rondins de bois reliés deux à deux par des U métalliques entrecroisés, des lucarnes très petites, situées en ras de plafond, au ras du sol à l'extérieur, n'avaient pas été obstruées ce qui fait que nous n'avions pas le sentiment d'être enfermées. Tout était éclairé électriquement bien sûr. Sous ces fenêtres on avait placé des escaliers du genre échelles.
Tout est devenu noir, je ne pouvais plus respirer...
Nous sommes restées dans les caves longtemps. Par deux fois, je grimpais à l'échelle, passais mon corps à travers la fenêtre, sortais ma tête pour voir les avions que nous entendions passer. Au troisième passage je grimpais à nouveau, cette fois les avions passaient au-dessus du bâtiment en le longeant alors que les précédents arrivaient perpendiculairement au bâtiment.
Je revois encore les trois triangles formés par les avions que je comptais : 18, je ne pouvais voir entièrement la formation. Je rentrais ma tête et me tournais vers mes camarades pour leur dire: «J'en ai compté 18». A ce moment là tout est devenu noir, je ne pouvais plus respirer, je mangeais de la poussière, je n'entendais plus rien, mes camarades se taisaient, puis tout à coup une d'entre elle s'est mise à prier, nous avons continué, j'étais toujours sur l'échelle la tête au plafond. Je ne sais pas combien de temps je suis restée seule. Soudain en face de moi une brève lueur, une expression traversa mon esprit «Les hallucinations d'Edgar». Pourquoi en un tel moment ? Je n'ai jamais su.
Soudain j'ai eu besoin du groupe. Comment ai-je traversé la cave ? Je ne me souviens pas! En tout cas j'étais à l'autre bout.
En tâtonnant j'ai trouvé l'emplacement d'une porte. J'ai continué à avancer. Dans la cave à côté de la nôtre il y avait bien un mètre de poussière, j'enfonçais. Nous nous étions toutes mises à tousser, une camarade m'a rejoint, la clarté s'est faite plus forte, nous avons constaté qu'un plancher s'était effondré ; j'ai trouvé dans le mur un emplacement dégagé par un bloc effondré, je m'y suis installée, j'avais le plancher de la «petite étude» au niveau de mon nez. Je levais les yeux, j'avais en face de moi, plus loin l'escalier, qui desservait les dortoirs, intact. Tout le reste était cassé, inexistant, disparu. Tout en haut, un lit laissait flotter ses draps au vent léger.
Je suis revenue près de ce que j'avais pris pour une porte ; des tuyaux emmaillotés de plâtre pendaient au mur, avec ma camarade nous avons pensé au gaz, nous nous sommes bien gardées de nous y accrocher.
Un petit oiseau chantait sa joie de vivre...
Au fur et à mesure que la poussière retombait nous y voyions mieux. Sur ma gauche, à travers le plancher effondré le ciel était bleu. Sur une branche d'arbre effeuillée, un petit oiseau chantait sa joie de vivre; massées nous l'écoutions. Puis apparurent, dans ce qui avait été la porte de la petite étude, deux Allemands de l'École Normale. je n'ai pas eu la présence d'esprit de crier, mais ma voisine a lancé un «au secours!» vibrant et toute la cave a crié aussi. Nous avons été entendues. Une de nous a dit «Il faut faire l'appel». Ce qui a été fait, nous connaissions la liste par cœur. Toutes, à notre tour nous avons répondu «présent».
Quel bonheur! Des petites 6ème sont venues vers nous. Là où nous avions vu les Allemands, un monsieur de la défense passive est apparu avec une bouteille d'eau «je ne sais plus si nous l'avons récupérée». Une petite 6ème a reconnu la voix de son père elle a crié «Papa, papa!» Il nous a dit «Ne bougez pas on va vous dégager, y a-t-il des blessés? Non!» Une camarade qui venait de Modane avait subi son 3ème bombardement, elle était choquée plus que nous. Je crois que c'est à ce moment que j'ai vraiment réalisé ce qu'était la guerre !
Finalement nous avons été dégagées côté cuisine, nous sommes arrivées à l'escalier au moment où des hommes de la défense passive, évacuaient sur un brancard une personne dont nous n'avons vu qu'un pied barbouillé de sang.
Sorties des caves nous suffoquions, nous avions du mal à retrouver une respiration normale. Pas de répit cependant, on nous informa qu'il y avait une bombe non éclatée dans la rue Marcoz, nous partîmes en courant, on nous dirigea vers une maison de la Société d'Électricité où on nous donna à boire. Plusieurs d entre nous ont vomi. Il était je crois plus de midi. Nous formions un triste spectacle. Les blondes étaient devenues brunes et les brunes toutes grises, nous étions sales, je crois que la peur commençait à me gagner. Je voulais fuir, je ne me souviens plus si j'ai pu récupérer mon vélo resté au lycée, ni comment j'ai rejoint Cognin où je trouvais ma tante toute affolée: une bombe avait été lâchée sur une ferme des alentours, il n'en restait rien.
Chambéry brûlait
Ce que je sais c'est que je n'ai pas pu rester à Cognin, je suis descendue à Chambéry : il fallait que je voie je me demandais si ce que j'avais vécu était bien vrai. A Chambéry j'allais de-ci, de-là, la ou l'on pouvait aller: Chambéry brûlait. Dans les caves de la rue Saint-Antoine des personnes appelaient, le feu sur la tête, les pieds dans l'eau, je crois qu'il y a eu des victimes. Je glanais de ci de-là, des renseignements sur le lycée bien sûr. Je n'ai retrouvé aucune de mes camarades, les familles étaient venues les récupérer. Légende ou réalité, des bruits couraient : cinq morts au lycée de filles, pas d'élèves mais la cuisinière et une aide de cuisine, remontées des abris pour assurer le repas. On disait même que la cuisinière en congé, elle mariait sa fille, était revenue peu avant le bombardement pour trouver la mort dans sa cuisine. Est-ce vrai? Est-ce faux?
La Sous-économe était revenue de l'école annexe de l'École Normale pour chercher et mettre à l'abri les cartes d'alimentation des internes normaliennes. On l'a retrouvée sous la véranda du bâtiment effondré côté internat. Dans les abris la surveillante générale d'internat a eu la poitrine écrasée par un bloc traversant les fameuses lucarnes, la 5ème victime je ne sais pas.
Pas de téléphone, des informations circulaient en tous sens
C'est fou les bruits qui ont couru. A une époque où il y avait très peu de téléphones, une tante habitant Ugine, informait mes parents à Chamoux sur Gelon que j'avais été isolée dans un coin. Les bruits circulaient à une vitesse folle, déformés à chaque relayeur.
Le lendemain je regagnais Chamoux à vélo, Chambéry brûlait encore. Nous étions en vacances le 26 mai 1944. Qu'il était long à trouver le sommeil! A chaque passage d'avions la nuit, je tremblais tant, que mon lit tambourinait sur la cloison et réveillait toute la maison. Je devais me lever et marcher dans la chambre.
Plus de 60 ans plus tard, lorsque j'entends passer un avion ou un hélicoptère il faut que je le voie pour être complètement rassurée.
Aujourd'hui je crois qu'il n'y a pas eu un, mais des bombardements multiples, ce jour là à Chambéry: suivant l'endroit où l'on se trouvait, suivant ce que l'on a vu, suivant ce que l'on a entendu, suivant sa propre sensibilité tout est différent. Une camarade de Chamoux élève à Jules Ferry sollicitée avec ses camarades pour aller aider à dégager les abris sur les boulevards ne veut toujours pas en parler : on a dit qu'il y aurait eu 200 morts dans ces abris. Je remercie encore les personnes qui ont aménagé les abris sous l'internat. Les bombes ont éclaté dans le bâtiment et non dans les caves. Quel carnage évité !
Ce petit oiseau qui chantait si joliment a été pour moi un détonateur, la vie était là à côté on devait en réchapper.
Roberte, interne, habitait Chamoux sur Gelon.
Roberte à aussi raconté :
la vie au lycée - en internat-, au fil de ces longues années de guerre
La rentrée de septembre 1943
- Normalement j'aurais dû être inscrite à l'école Jules Ferry. Venant du cours complémentaire de Chamoux sur Gelon, je n'avais qu'une seule langue étrangère : l'italien.
- Jules Ferry, n'ayant pas de classe anglais 2ème langue débutant, au niveau de la seconde, me dirigea vers le lycée de jeunes filles de Chambéry. Ayant obtenu plus de 12 de moyenne au brevet élémentaire j'ai pu intégrer la classe des normaliennes; nous étions 4 élèves dans ce cas désigné par le terme: «assimilé aux normaliennes» qui pour la plupart n'avaient appris qu'une seule langue l'italien à cause de la proximité de l'Italie.
- Le Lycée présente la forme d'un U très étiré, la base s'appuyant sur le parc du Verney. L'aile de l'internat longeait l'avenue Pierre Lanfrey, l'aile- classe amphithéâtre et laboratoire- se trouvait près du Lycée de garçons.
L'École Normale occupée par la Kriegsmarine
- Le régime de Vichy avait décidé d'intégrer les normaliennes aux élèves du Lycée : il réalisait une économie d'enseignants. Elles étaient intégrées au lycée depuis 1941 - 1942. Nous formions une classe appelée classe de M2 pouvant prétendre passer le BAC avec une seule langue: italien ou anglais.
- Les locaux de l'École Normale, rue Marcoz étant libérés furent occupés par les troupes étrangères en 1943, il s'agissait d'officiers allemands, nous disions de la Kriegsmarine, au costume bleu foncé. Bien entendu les dortoirs des normaliennes furent vidés de ses internes, elles purent s'installer dans les dortoirs du lycée. Se trouvant dans le périmètre sensible de la gare, l'internat avait été fermé pour les internes lycéennes qui logeaient en ville chez des correspondants. Je dormais moi chez une grande tante à Cognin, je faisais le trajet à bicyclette matin et soir. A midi je mangeais dans un restaurant rue Jean-Pierre Veyrat. C'était un internat très émancipé pour l'époque.
Après-la guerre, Sainte-Hélène
Par la suite, après la guerre, l'internat a fonctionné à Sainte-Hélène dans le quartier de Montjay, nous faisions le trajet matin et soir à travers l'ancien Faubourg Mâché en empruntant la rue des Bernardines avec la fontaine des «Deux Bourneaux», le réfectoire du lycée de garçons fonctionnant dans des baraquements situés dans la cour.
Élisa Compain se souvient à son tour:
Avoir quinze ans en 1944....
Élisa Francaz (épouse Compain), en classe de 3ème
Avoir quinze ans en 1944, c'est avoir connu, plus ou moins, la faim le froid, la misère vestimentaire, des ennuis de santé bénins ou graves, c'est avoir éprouvé la méfiance et la peur. Et pourtant, à Chambéry, nous étions privilégiés par rapport aux habitants des grandes villes qui connurent une pénurie bien plus grande ou à ceux des centres stratégiques qui subirent tant de bombardements.
La nourriture
En tant que J3, nous avions droit à des rations de 350 g de pain par jour, de sucre par mois, un peu de viande, de beurre, de fromage, et, de temps en temps, un « ersatz » de bonbons à la saccharine ou un quart de litre de lait écrémé.
Les rations de pain peuvent sembler énormes aujourd’hui, même si certains tickets servaient à des achats de farine pour quelque extra culinaire. Mais ce pain noirâtre et indigeste était la partie la plus nourrissante de notre alimentation et pour éviter les chamailleries entre frères et sœurs, certaines mamans pesaient quotidiennement les rations des membres de la famille.
Pommes de terre, haricots secs très appréciés étaient devenus des denrées rares et ceux qui n avaient ni parents à la campagne, ni les moyens d'acheter au marché noir devaient souvent se contenter de raves ou de bettes cuites à l'eau.
Nous avons apprécié les distributions qui, à la récréation de 10 heures venaient calmer nos fringales: en 1943, du lait en poudre allongé de beaucoup d'eau ou du chocolat avec fort peu de cacao, en 1944, des biscuits à la caséine un peu plâtreux mais consistants.
Dans l'ouvrage « Cent ans, du lycée de jeunes filles au collège Louise de Savoie » page 125, description très colorée des menus à l'internat pendant la guerre par Renée Bellot (Troillard) élève de 1940 à 1947.
Le froid
Les hivers de la guerre furent, je crois, particulièrement froids: la Leysse était gelée ainsi que l'étang de Bissy qui tenait lieu de patinoire.
Les rations de charbon étaient réduites et la qualité généralement médiocre: la tourbe extraite des marais aux environs de Chambéry n'apportait guère de chaleur, l'anthracite des mines d'Aimé contenait beaucoup de pierres qui, à défaut de brûler, maintenaient un volant de chaleur quand le feu était éteint.
La plupart des familles vivaient entassées dans la cuisine et la chaleur animale compensait partiellement le carences du chauffage. Dans les autres pièces, l'hiver, les vitres étaient obstruées par le givre qui dessinait d'artistiques feuillages. Le soir, une bouillotte parvenait à tiédir le lit, mais elle refroidissait et l'on se recroquevillait «en chien de fusil» pour profiter de sa propre chaleur. Que le réveil était brutal pour la dormeuse remuante qui allongeait un pied vers le fond du lit glacial et qu'il était dur de se tirer de cet espace réduit mais tiède pour affronter le froid matinal!
Au Lycée, dans la plupart des classes, les radiateurs électriques dispensaient pendant un quart d'heure une chaleur brûlante puis s'éteignaient pour une heure ou deux. Le bâtiment principal avait le chauffage central au charbon et, aux périodes les plus froides, la température dans les salles d'étude et les bureaux ne dépassait pas 11 à 12 degrés.
Vêtements et chaussures
Malgré les restrictions, nous et les « bons » donnant droit à l'achat d'un vêtement neuf (de très mauvaise qualité) étaient rares. Alors, les mamans s'ingéniaient: un large ruban de velours servait à allonger une jupe ou à élargir un manteau; avec de la laine détricotée de deux pulls usés, elles en faisaient un troisième a dessin bicolore, car il ne fallait surtout pas «que cela paraisse être une rajouture»!
Et ces vêtements, nous les portions usés jusqu'à la corde: mise sens devant derrière- une jupe élimée par une selle de vélo (au point d'être rendue transparente) pouvait encore tenir quelques mois. Et les heure: consacrées au raccommodage, notamment des fameuses chaussettes obligatoires au Lycée! Les lessives médiocres, les savons sableux agressaient ce linge devenu si rare.
Pour les chaussures, c'était plus difficile encore. Il fallut donc supporter les souliers devenus trop petits et peu étanches, les galoches en mauvais cuir et à semelle de bois trop tendre qui s'usait si vite.
Toute propension à l'élégance n'était pourtant pas bannie. Il existait des sabots plus chics, avec des semelles aux couleurs vives. Quelques privilégiées, grâce à des trocs sans doute, pouvaient exhiber des vêtements de qualité, en bon état et à la mode: veste longue à épaules carrées, jupe ample mais courte.
Mais toutes essayaient de paraître le moins minables possible. Aucune élève ne serait allée au Lycée avec des habits déchirés, par souci de correction mais aussi parce qu'un vêtement non réparé est trop vite en lambeaux. Le dimanche, chacune mettait ses meilleurs habits, son plus beau calot ou, mieux son chapeau, car les chapeaux restaient en vente libre: ceux qui étaient à la mode en 1944 ressemblaient aux chapeaux d'Artémise et Cunégonde Fenouillard.
Les problèmes de santé
L'hiver entraînait un cortège de rhumes et de sinusites rebelles à toutes les gouttes nasales noirâtres et nauséabondes. Le froid et sans doute les carences alimentaires favorisaient les engelures: ah! les oreilles brûlantes, les orteils gonflés comprimés dans les chaussures trop petites, les doigts transformés en petits boudins douloureux! Seul remède: baigner les engelures dans l'eau de cuisson des céleris (légumes en vente libre)... Il y eut aussi au Lycée quelques cas de gale, pudiquement qualifiée de « gale du pain ».
Avec la mauvaise alimentation se multipliaient les affections diverses: caries dentaires, éruptions exacerbées par des savons trop abrasifs, ennuis digestifs souvent simplement désagréables mais parfois graves avec des jaunisses, des appendicites, des péritonites (une lycéenne en est morte en 1944).
Par contre, il n'y eut, au Lycée, que quelques cas de primo-infection tuberculeuse alors que la maladie a fait des ravages parmi les étudiants.
La méfiance et la peur
Nous avions appris à taire les choses importantes.
Ne pas se vanter des moyens employés dans la famille pour se procurer un peu plus de nourriture: parents à la campagne pour beaucoup, marché noir sans doute pour d'autres.
Ne pas répéter au Lycée les réflexions peu amènes entendues à la maison à propos du gouvernement.
Ne pas citer les messages souvent amusants de la radio anglaise dont l'écoute était interdite.
Ne pas raconter qu'un cousin parisien requis par le STO était hébergé chez nous ou qu'une amie de la famille avait été incarcérée à la caserne Curial parce que son mari faisait de la résistance.
Ne pas évoquer cette villa de la rue François Charvet avec des cellules d'1,50 mètres de côté aménagées dans la cave et des salles «d'interrogatoires» au dessus.
Ne jamais parler des parachutages d'armes ou des sabotages dont nous avions eu l'écho, car des informations circulaient, fragmentaires, entre gens de confiance mais ne devaient pas filtrer à l'extérieur. En effet, nous savions beaucoup de choses concernant des activités clandestines.
Nous savions aussi que le destin est souvent aveugle, que des balles qui ne vous étaient pas destinées blessaient ou tuaient: nous en connaissions des victimes.
Nous savions que des villes pouvaient être bombardées: Modane, Annecy l'avaient été. Pourtant pendant les alertes nous n'y croyions guère et nous échangions des plaisanteries dans les abris. Pourtant quand les bombes sont tombées, même celles qui, comme moi, ont assisté d'un peu loin au bombardement, ont frémi, sentant la mort, là, toute proche.
Car nous avions peur de la mort, bien sûr, peur aussi d'un avenir que nous n'osions pas imaginer.
Nous avons appris que rester en vie tenait parfois à peu de choses. Nous avons appris la prudence, l'horreur du gaspillage, celui de la nourriture ou des vêtements, mais aussi de tout ce qui pouvait resservir: un bout de ficelle, un morceau de papier. Nous avons appris un certain fatalisme: envoyés à la campagne pour éviter un éventuel deuxième bombardement de Chambéry, nous avons côtoyé plus de dangers que si nous étions restés chez nous Nous avons appris que l'opportunisme, la lâcheté existaient mais aussi la générosité et le courage. Nous avons appris que la brutalité et la sauvagerie pouvaient dépasser tout ce que nous pouvions imaginer.
Des traces indélébiles?
Les années sombres, au sens propre comme au figuré.
Depuis la déclaration de guerre, la défense passive veillait à ce que, la nuit, les avions ennemis ne puissent pas repérer, grâce aux lumières, les zones habitées. Dès la tombée du jour, les fenêtres ne devaient plus laisser passer la moindre lueur: il avait fallu obturer les fentes des volets avec des papiers de couleur sombre. peindre en bleu les fenêtres sans volets (des traces en ont subsisté jusqu'au déménagement de 1988 dans le bâtiment des Archives départementales). Dans les rues, les lampadaires diffusaient une chétive lueur bleuâtre.
Dans les maisons, souvent les pièces étaient éclairées par une unique ampoule et lors des baisses de tension le filament rougeoyant n'éclairait guère. Et lors des coupures de courant, faute de pétrole, il fallait recourir à des lampes à carbure dont les joints peu étanches laissaient filtrer des gouttes d'eau qui déclenchaient des mini explosions. Ceux qui n'en possédaient pas ou ne pouvaient se procurer du carbure s'éclairaient à la bougie ou, plus sommaire au «rat de cave», filament enduit de stéarine ou succédané.
Se déplacer
Les autos n'étaient pas très nombreuses avant la guerre et en 1939 l'armée en avait réquisitionné, en particulier les tractions Citroën. Par la suite, seules avaient été autorisées à circuler, uniquement les jours ouvrables, celles qui étaient utiles à des professionnels. Mais les rations d'essence de plus en plus réduites obligeaient, par exemple les médecins, à circuler à bicyclette pour des visites à domicile: j'ai ainsi vu le docteur Belly arriver un matin d'hiver, chapeau et pardessus couverts de neige après un parcours de plus de 3 km.
On vit réapparaître quelque fiacres. Pour des transports dans Chambéry et environs immédiats, la société Blache utilisait des voitures tirées par un cheval, de même que l'entreprise Davignon pour livrer des pains de glace aux nombreux commerçants qui ne possédaient pas de frigorifique. Pour des livraisons moins lourdes, les « express chambériens » pédalaient sur des bicyclettes traînant une remorque. Des camions équipés de gazogène faisaient des transports à moyenne distance: il n'était pas question de déplacements plus lointains.
Pour les personnes, une ligne d'électrobus joignait Chambéry à Challes. Il existait aussi des entreprises de cars qui reliaient les principaux chefs-lieux de canton à Chambéry ou à la plus proche ville voisine. Ces cars étaient généralement bondés au delà des limites de sécurité et des voyageurs étaient entassés dans le couloir, obligés parfois de se tenir sur un seul pied pendant des kilomètres....
On a vu aussi des jeunes gens installés sur le toit au milieu des bagages.
Les trams étaient également pris d'assaut malgré l'inconfort de wagons vétustés aux banquettes de bois, mais les voyageurs y étaient tout même moins serrés que dans les cars. Gros avantage, les trains pouvaient aussi transporter les vélos, indispensables pour parcourir les campagnes à la recherche d’un peu de ravitaillement.
Aux beaux jours c’était dans les villages un défilé de cyclistes, sportifs involontaires, essayant d'acheter ici ou là, quelques œufs, des haricots secs, du vin ou de troquer une paire de sandales ou un vêtement « presque neuf » contre de l’huile, de la « gnôle » ou du tabac. Encore fallait-il au retour, éviter le regard suspicieux du contrôleur du ravitaillement. Jusqu’en 1941 ou 42, on put (difficilement) se procurer des vélos de médiocre qualité, mais il n’était plus question d’en acheter de neufs en 1944.
Les pneus, surtout ceux des années de guerre en caoutchouc «artificiel» ( ?) s’usaient sur les toutes de campagne souvent simplement empierrées. Il fallait les «gonfler à bloc» et s’ils éclataient un rechapage sommaire leur permettait de durer encore un peu. Il s’est vendu des boudins métalliques qui s’avérèrent peu fiables. Si bien qu’on a vu des cyclistes rouler sur les jantes ! Et ne parlons pas des freins peu efficaces, des dérailleurs qui se coinçaient dans les rayons des roues. Et pourtant, ils en ont porté, des chargements, ces vélos : le petit dernier de la famille sur une selle vissée sur le cadre de vélo du Papa, un cageot sur le porte-bagage arrière, deux sacs au guidon !
La bicyclette était plus que jamais la «petite reine».
Attendre
À chaque fin de mois, attendre au secrétariat de mairie la distribution des tickets pour le mois suivant : l’un des employés contrôlait la carte d’alimentation et les autres délivraient tour à tous les tickets de pain, de matières grasses, de viande, de « denrées diverses ».
Les attentes étaient longues dans les magasins car les commerçants devaient découper les tickets puis peser les rations au plus juste (plutôt moins que plus chez tel ou tel, disaient les esprits chagrins). Il fallait donc attendre: tous les matins, à la boulangerie pour le pain quotidien, à l'épicerie pour le quart de litre de lait du J2, ou deux ou trois fois par mois, pour quelques dizaines de grammes de beurre, attendre en fin de semaine à la boucherie pour un peu de viande coriace.
Attendre au guichet de la gare, au départ du car, au cinéma...Que d'heures passées à «faire la queue»!
Et bien sûr nous avons attendu impatiemment le débarquement allié, puis la Libération, l'armistice (Ah! Ce joyeux monôme en cette matinée du 8 mai 1945 et, le soir, la liesse dans la rue de Boigne, en dépit des ruines du bombardement, et en dépit de la guerre qui continuait dans le Pacifique). Les prisonniers de guerre et leur famille ont longuement attendu leur retour. Attente qui fut souvent vaine pour les déportés et, pour ceux qui revinrent, décharnés et si faibles, attendre un lent et incertain rétablissement.
Pendant plusieurs années, il a fallu attendre la fin des restrictions et attendre plus longtemps encore la reconstruction des ruines de longues années, une longue patience...
Le patriotisme officiel
Chaque lundi matin avait lieu le « salut au drapeau ». Classe par classe, nous nous rangions sur trois côtés de la cour de l'externat. En face, se dressait un mât tricolore et, à tour de rôle, les deux meilleures élèves de chaque classe hissaient le drapeau au moyen d'une corde et de poulies.
La Directrice, Madame Carteron nous adressait un petit discours, mais sa voix était faible et, malgré notre silence, nous n'en percevions que des bribes nous exhortant au travail, à la franchise, etc.
Nous chantions un couplet de la Marseillaise, le drapeau était redescendu et, en rang, nous montions dans nos classes.
Aux beaux jours, la cérémonie n'était pas désagréable, mais en hiver, il fallait rester immobile dans le froid.
Madame Carteron avait très vite le nez rouge et les yeux larmoyants, tandis qu'à ses côtés, Mademoiselle Déclert, la Surveillante Générale, semblait insensible aux intempéries.
Un jour, la cérémonie se termina dans la cacophonie: tandis que sous la direction du professeur de musique nous chantions docilement « Amour sacré de la Patrie... », quelques grandes élèves entonnèrent le premier couplet de la Marseillaise. Naturellement, nous eûmes droit à un chapitre de morale, d'autant plus que la Directrice venait d'insister sur la nécessité de l'ordre et de la discipline (à ce qu'on nous en dit, car nous n'avions pas mieux entendu qu'à l'ordinaire).
La plupart d'entre nous n'avaient rien compris à l'affaire, mais quelques élèves mieux renseignées nous expliquèrent: le premier couplet (entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats) passait pour gaulliste tandis que l'autre avait la préférence du Maréchal Pétain.
Suivant les consignes officielles, le portrait du « Maréchal » trônait au dessus du bureau dans chaque salle de classe. Nous en avions l'habitude depuis la classe de 6ème et nous ne le remarquions même plus. L'administration et les professeurs appliquaient les ordres reçus, sans zèle excessif; me semble-t-il. Ainsi, lorsque, entre 1940 et 1942, tous les écoliers durent envoyer une lettre ou un dessin au Maréchal, au Lycée, personne ne nous obligea à le faire et l'on mit simplement une boîte aux lettres à notre disposition. Je ne pense pas qu'il y eut beaucoup d'œuvres déposées.
Par contre, lorsque des portraits de Pétain furent subtilisés dans quelques classes, la Directrice intima aux coupables l'ordre de les remettre en place -sans résultat, vraisemblablement.
Dans son discours de la distribution des prix en juillet 1945, Madame Carteron rapporta un incident ignoré jusque là. Dans le parloir, «le portrait du Maréchal coupant les motifs triangulaires de la tapisserie fut entouré de V séditieux ; pour cela, notre Lycée fut taxé de gaulliste et une enquête fut ouverte»2
mai 2015 - Témoignages Roberte Burnier et Élisa Compain. Mise en ligne A.Dh.
Sources
1- Le Lycée sous les bombes - des lycéennes racontent l'Occupation - publication de l'Association des Anciennes élèves du Lycée Louise de Savoie de Chambéry - achevé d'imprimer / dépôt légal oct 2008
2- Archives départementales de Savoie 994 W14.
Nous remercions Roberte et Élisa qui nous ont communiqué ce document, et ont accepté que nous en tirions leur témoignage. Pour plus d'informations sur l'Association des Anciennes élèves du Lycée Louise de Savoie de Chambéry : Collège Louise de Savoie, Chambéry